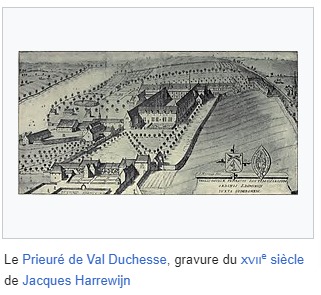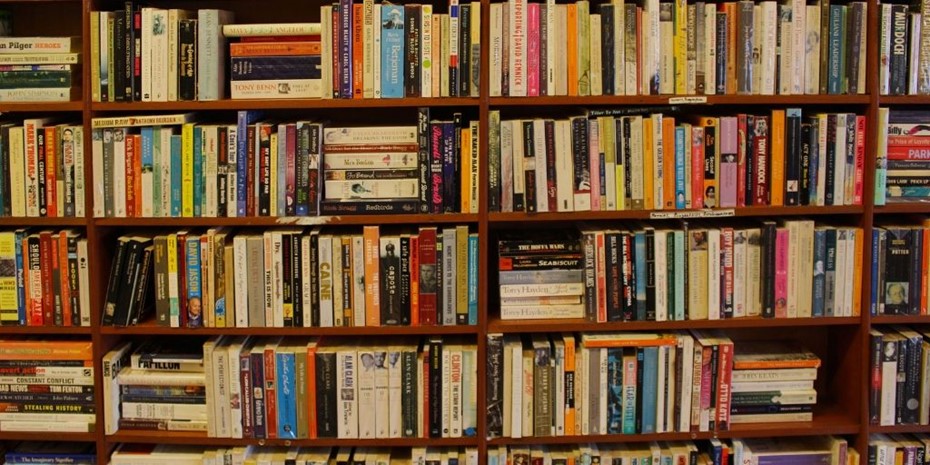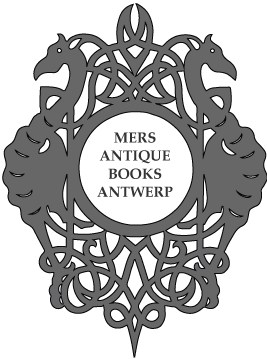Search
CATEGORIES
We found 1 book
We found 0 news items
We found 1 book
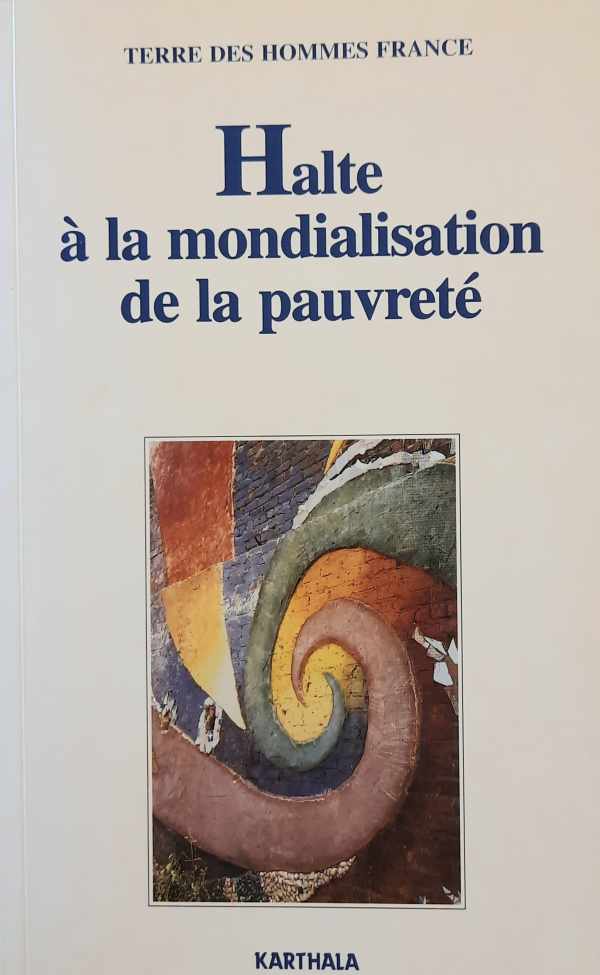
 Broché, in-8, 396 pp.
Broché, in-8, 396 pp.A l'heure où nous approchons d'un nombre de six milliards d'habitants sur la planète, les inégalités dans la jouissance des droits sociaux, économiques et culturels, loin de se réduire, ne font qu'augmenter. L'utopie égalitariste du début du siècle ne s'est pas réalisée, et l'on assiste toujours à l'exploitation de l'homme par l'homme. Les véritables esclaves de notre époque sont tous ceux qui sont tenus à l'écart du savoir, du crédit et du contrôle de leur outil de travail. Récession, chômage et exclusion se conjuguent au Nord comme au Sud, sous des modes divers. Comment, alors, exercer sa citoyenneté lorsque les droits économiques et sociaux minima ne sont pas assurés ? Terre des Hommes a coordonné une réflexion autour de ces grands axes visant à établir un code des droits économiques, sociaux et culturels, à la fois universel et respectueux des différences, qui puisse régir les relations entre les hommes à l'échelle de notre monde.
We found 0 news items

Statuts du CCN:
Article premier. - En vue de continuer l'Oeuvre du Congrès Colonial National des 18 et 20 décembre 1920, conformément à la décision unanime de ce Congrès, il est institué un Comité Permanent du Congrès Colonial National (CPCCN)
Article 2. — Le CPCCN a pour but :
1° d'examiner les voeux émis par des membres du Congrès et d'en poursuivre éventuellement la réalisation;
2° d'étudier et de suivre les questions coloniales principalement au point de vue des solutions actuelles et pratiques qu'elles comportent ;
3° de susciter dans le domaine de l'initiative privée les entreprises et les oeuvres de nature à favoriser l'action civilisatrice dans la Colonie et l'essor économique colonial tant de la mère-patrie que du Congo Belge;
4° d'intéresser le monde industriel et commercial belge à l'entreprise coloniale;
5° de préparer et organiser périodiquement des Congrès Coloniaux Nationaux.
Article 4. - Le Comité se renouvelle par cooptation et se complète s'il y a lieu, sans pouvoir toutefois dépasser le nombre de 100 membres.(3)
CONGRESSEN:
I. 1920: Congrès colonial national 18, 19, 20 décembre 1920. Palais de la Nation. Compte rendu des séances. Bruxelles : Lesigne, 1921. MERS bezit deze verslagen niet.
II. 1924: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 333 pp.
IIbis. 1925: Rapport 'La politique financière du Congo Belge' (Cooreman, Fortin, Max-Léo Gérard, Max Horn, Mahieu, Van de Ven, Louwers, Périer, Crokaert), ingeleid door Octave Louwers. MERS bezit het rapport en de verslagen: 155 pp. In de bijlagen een overzicht van de portefeuille van de kolonie waarin de portefeuille van de 'Fondation de Niederfüllbach' (gedeeltelijk) geïncorporeerd is en dit ingevolge de Conventie van 29 juni 1923.
IIter. 1926: MERS bezit Résumé des études du Comité Permanent du Congrès Colonial door Octave Louwers (99 pp.). Deze samenvatting is BELANGRIJK wegens een gewijzigd inzicht in de methoden van het kolonialisme.
III. 1930: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 277 + 203 pp.
IV. 1935: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 144 + 129 pp. (1)
V. 1940: MERS bezit de rapporten, niet de verslagen: 741 + ? pp. (2)
VI. 4 en 5 oktober 1947 (normaal had dit in 1945 moeten plaatsvinden)
VII. jaar voorlopig onbekend
VIII. jaar voorlopig onbekend
IX. 1953: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 250 pp. in één band
X. 1954: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 221 pp. in één band
XI. 1955: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 221 pp. in één band
XII. 1956: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 528 pp. in één band
XIII. 1958: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 333 pp. in één band
Het is ons voorlopig onbekend of er congressen waren in 1959 en 1960.
(1) Anomalie: In 1935 droegen de stukken 'Congrès Colonial Belge'. Op dit congres waren er enkele tussenkomsten deels in het Nederlands.
(2) Het Congres vond plaats eind april 1940.(bron: IAI, 1948) Het is mogelijk dat de verslagen niet gepubliceerd werden wegens het uitbreken van de oorlog. Heyse schrijft hierover in 1949: 'Les travaux de ce Congrès n’ont pas été publiés et les rares tirés-à-part de quelques communications sont fort difficiles à réunir.' [Grandes lignes du Régime des terres du Congo belge
et du Ruanda-Urundi et leurs applications (1940-1946)] REF MERS 194906314578.
(3) Dit artikel wijst erop dat de 'think tank' voor en de 'decision makers' van de kolonie met niet meer dan 100 konden zijn. Dat stemt overeen met vaststellingen die Stengers en Vellut later hebben gedaan: wat er in Belgisch Congo diende te gebeuren werd beslist door een zeer kleine groep 'notabelen'.
les rapports et les comptes rendus

• consistent en des transferts du droit d’exploitation ou de contrôle des terres au moyen bail ou de la concession;
• couvrent des surfaces de 200 hectares ou plus;
• ont été initiées depuis l’année 2000;
• impliquent une conversion potentielle des terres (souvent de pâturages extensifs et de services écosystémiques vers un usage agricole);
• concernent les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. Les opérations minières ne sont pas inclues.
L’objectif de ce profil pays est de présenter ces données sur les transferts foncier à grande échelle au niveau national à un large panel de parties prenantes, d’encourager les contributions et le partage de données afin d’améliorer de façon continue la Land Matrix. Les données utilisées pour ce profil ont été téléchargées sur Land Matrix le 05 Avril 2018.

Malgré le caractère "conséquent" de la citation, j'ai tenu pourtant à garder ce chapitre intact et complet car sa richesse et son contenu donne un éclairage très particulier, que je n'ai pas souvent rencontré, de la révolution Française dans son ensemble et une vue précise de l'agonie du château d'allassac.
Il me semble évident qu'une certaine forme de partialité concernant la période révolutionnaire se dégage de ce texte, même si les faits exposés semblent avoir été vérifiés et prouvés, il n'en reste pas moins que les actions décrites mettent surtout l'accent sur le vandalisme de la révolution, et laissent plus largement sous silence les motivations souvent justifiées de certains de sortir d'un régime que nous n'avons toutefois jamais vraiment quitté. N'ayant pas souvent sous les yeux la vision qua pu avoir l'auteur il m'a semblé interessant de la partager.
A plusieurs reprises lors de la lecture, l'auteur se livre à des analyses qui semblent pertinentes et il sait mettre en avant les arguments que nous utiliserions encore aujourd'hui. De même, une fois passé le vocabulaire tranchant qu'il utilise pour qualifier certains groupes on découvre une personnes avisée et clairvoyante sur la nature humaine.
Pour le reste, la description des biens et de l'histoire de leur disparition est une pure merveille de rédaction et de précision qu'il m'est difficile de couper. Jugez en par vous même :
La curée
Le plus important est fait; la famille de Lamase est en exil; ses grands biens sont privés de l'oeil du maître ; il s'agit maintenant de les priver du maître lui même, de les nationaliser, en un mot. Pour cet objet, il n'y a plus qu'à laisser le plan révolutionnaire se développer dans toute sa beauté. Ce plan est simple : les propriétaires dont la fortune est adjugée d'avance aux affiliés sont d'abord contraints de sortir de France ; on les empêchera ensuite d'y rentrer; on les punira de la confiscation pour être sortis ou pour n'être pas rentrés, et le tour sera joué.
L'Assemblée Constituante accomplit en deux ans la première partie du programme. Elle provoque le désordre, elle encourage l'émeute, l'assassinat et le pillage; elle renverse les lois et coutumes établies depuis des siècles; elle anéantit les parlements et les anciennes juridictions indépendantes; elle les remplace par des tribunaux dont les juges sont à la nomination du pouvoir politique, par conséquent à sa dévotion. Toutes les institutions garantissant la vie et les propriétés des sujets du roi sont supprimées en théorie quand cette assemblée de malheur passe la main à la Législative, au mois d'octobre 1791. Les bons citoyens ne peuvent plus se faire aucune illusion. Le roi, avili et sans force, est incapable de les protéger; plus de cent mille familles vont chercher à l'étranger le minimum de protection auquel a droit tout homme civilisé.
Il ne faut qu'un an à la Législative pour exécuter la deuxième partie du programme, pour ouvrir l'ère des injustices les plus criantes, des scélératesses les plus effrontées.
Quand elle aura terminé son oeuvre, toutes les victimes désignées seront solidement ligotées; la Convention et le Directoire n'auront plus qu'à frapper dans le tas, les yeux fermés. Il ne sera même plus nécessaire de disposer de tribunaux dociles pour priver les citoyens de leur liberté, de leur fortune, au besoin de leur tête. Celle-ci sera parfois à la discrétion des geôliers qui s'amuseront à massacrer vingt-cinq ou trente mille prisonniers dans les premiers jours de septembre 1792; les survivants, on les laissera mourir de faim au fond des geôles puantes, ou on les guillotinera. Le résultat sera le même. Ni les uns ni les autres ne viendront réclamer leurs biens, et c'est le seul point essentiel.
J'ai dit que la Législative avait rétabli la loi de confiscation et aboli le droit naturel d'aller et de venir dont les Français avaient toujours joui.
L'acte d'émigration ayant passé « crime » digne de mort et de confiscation, l'heure avait sonné en Limousin de faire main basse sur le patrimoine du plus incontestablement riche et du plus bienfaisant seigneur de la contrée. Dès le mois de septembre 1792, mon bisaïeul fût inscrit sur la liste des émigrés. De quel droit ? Ses bourreaux ignoraient le lieu de sa retraite et ils ne firent aucune démarche pour la découvrir. M. de Lamase vivait à l'écart; dès que les jours devinrent très sombres, il avait pris un correspondant à Strasbourg, et toutes les lettres qu'il fit parvenir de sa retraite à ses compatriotes sont datées de cette ville alors française. Les prescripteurs devaient présumer qu'il n'avait pas franchi la frontière .
En l'inscrivant, sans plus ample informé, sur les tablettes de l'émigration, les administrateurs du district d'Uzerche, préjugeant le « crime » sans le constater, commettaient une première forfaiture. Je la signale ici pour mémoire, le chapitre suivant devant établir que le « coupable » ne fut jamais émigré, au sens que les lois homicides de l'époque attachaient à ce mot.
Les scellés furent apposés sur ses meubles et ses biens-fonds placés sous séquestre. C'était la première formalité de la dispersion aux quatre vents d'une fortune acquise par dix générations, au prix de mille efforts d'intelligence et d'économie.
Deux des frères de Jean de Lamase et un de ses fils, qui tous trois étaient restés dans leur province ou y étaient revenus, essayèrent d'obvier aux effets désastreux de cette mesure préparatoire en opposant à son exécution des moyens dilatoires, soit en revendiquant leur légitime sur les héritages, soit en se faisant nommer séquestres de quelques domaines, soit encore en rachetant aux enchères les meubles auxquels ils étaient particulièrement attachés.
Pauvres moyens ! Au jeu de l'intrigue les honnêtes gens en lutte avec les malfaiteurs ont toutes chances de succomber, car il est écrit depuis trois mille ans que « les enfants des ténèbres sont mieux avisés que les enfants de lumière dans la conduite des affaires temporelles ».
On le fit bien voir à ces infortunés. Les persécutions qu'ils endurèrent sur place furent parfois plus amères que celles de l'exil. Ils furent aussi bien et aussi complètement volés que le chef de famille... et bernés, par-dessus le marché ; ce qui est plus humiliant que d'être assassiné.
Quand on voulut mettre en vente les immeubles séquestrés, aucun acquéreur sérieux ne se présenta, tout d'abord.
C'était au commencement de 1793. Les fermiers seuls auraient eu l'audace de s'approprier les terres qu'ils avaient le cynisme de faire valoir, pour le compte de la nation; mais comme ils ne croyaient point à la durée de l'orgie; comme, d'autre part, ils ne payaient au département qu'un prix de fermage dérisoire, ils préféraient de beaucoup profiter de l'aubaine pour épuiser les champs et les vignes, en tirer le plus possible de revenus annuels et mettre ces revenus, convertis en numéraire, à l'abri des retours de la fortune.
Les paysans, les vrais, ceux qui mangent leur pain à la sueur de leur front, éprouvaient une horreur invincible à se souiller d'un vol perpétré à la face du soleil.
Leur conscience était restée et reste encore foncièrement respectueuse de la propriété d'autrui. Il existait, sur la question, un précédent qui leur fait trop d'honneur pour que je m'abstienne de le raconter ici où il trouve naturellement sa place.
Vers le commencement du seizième siècle, un Pérusse des Cars avait consumé sa fortune en fondations d'hôpitaux et d'autres bonne oeuvres. Afin de subvenir aux besoins de ses onéreuses créations, il avait hypothéqué la part de patrimoine que la loi lui interdisait formellement d'aliéner, sous n'importe quelle forme.
Ses dettes étaient donc nulles légalement ; mais le pieux seigneur n'entendait point rendre des créanciers confiants victimes de libéralités exagérées. En un testament admirable de piété et d'honneur il rendit compte à ses enfants de la situation, les suppliant, en vue du repos de son âme, de tenir pour bons et valables les engagements prohibés qu'il avait pris.
Ceux-ci cherchèrent à se conformer à ses désirs, mais ils rencontrèrent, pour l'exécution, une résistance opiniâtre dans la volonté des créanciers qui ne voulaient pas être payés et dans le refus des habitants d'acheter les terres qui servaient de gages aux créances. De guerre lasse, les des Cars abandonnèrent les domaines engagés, purement et simplement.
L'un de ceux-ci consistait en une vaste prairie attenant au fief de Roffignac. Pendant cent ans et plus cette prairie resta close comme lieu sacré, tabou. La cloture tomba enfin d'elle-même et l'enclos devint, par la force de l'habitude, bien communal où chacun menait, à son gré, paître son bétail ; c'était, plutôt qu'un bien communal, une prairie nullius. Elle a traversé même la révolution dans ces conditions, et ce n'est qu'après 1860 qu'elle a trouvé un acquéreur, lequel a déposé le prix d'achat dans la caisse municipale.
Si les vrais paysans persistaient dans leur aversion du bien d'autrui, les autres, les petits bourgeois des environs et les passe-paysans, pour qui la révolution semblait avoir été faite, témoignaient encore de la méfiance.
Les propriétés de mon arrière-grand-père étaient d'ailleurs offertes en bloc, et j'ai pu me convaincre qu'à cette époque, il en avait été de même dans presque toute la France.
En refusant de morceler les latifundia, la république montrait ainsi qu'elle entendait ne rien faire pour le menu peuple et qu'elle désirait simplement présider à la substitution de riches par d'autres riches... Mais allez faire comprendre cette claire vérité aux malheureux enivrés des mots sonores de Liberté et d'Egalité !...
En attendant que la Convention autorisât le morcellement, d'abord en gros lots, puis en lots minuscules, on s'attaqua aux divers mobiliers qui garnissaient les châteaux ou les simples maisons de l'exilé.
Je ne m'occuperai que du mobilier de Roffignac et de celui d'Uzerche.
L'invasion de Roffignac, le 25 janvier 1790, par les émeutiers et les gardes nationaux de Brive, complices du désordre et du pillage, avait considérablement détérioré les richesses amoncelées dans l'antique demeure. Les procès-verbaux officiels, rédigés quelques jours après l'événement, ne parlent que de placards éventrés, d'étoffes lacérées, de barriques de vin et d'eau-de-vie défoncées, de glaces brisées, et sont muets d'ailleurs sur le nombre et la nature des meubles emportés, quoiqu'il fût notoire que chacun des envahisseurs en eût pris à sa convenance, sans être le moins du monde inquiété !
Les chaumières des environs et aussi nombre de maisons bourgeoises s'étaient largement approvisionnées de lits, de couvertures, de draps, de serviettes, de fauteuils, de chaises, de tableaux de prix et de miniatures représentant de petits amours devant lesquels les femmes des voleurs s'agenouillaient pieusement, les prenant pour des Enfants Jésus.
Cependant la conscience des paysans se tourmente facilement ; elle est plus craintive que celle des messieurs ; la peur d'un retour offensif de la justice humaine les talonnait. Ils se défirent, moyennant quelques sous, des objets de valeur qu'ils étaient d'ailleurs incapables d'apprécier.
Les beaux meubles ne tardèrent pas à orner les logis bourgeois de la contrée ; ce fut bientôt un luxe à la mode, parmi les familles comme il faut et inclinées dans le sens de la révolution, de se faire honneur d'objets artistiques ayant appartenu bien authentiquement au château de Roffignac.
Cette mode n'est pas tout à fait éteinte au bout d'un siècle révolu.
Je sais un grand prêtre du droit, aujourd'hui mort, forcé de son vivant, — fait unique dans les annales de son Ordre — de vendre sa charge pour y avoir exécuté des tours de sa façon, qui s'est rendu acquéreur, au prix de 400 francs, d'une vaste armoire armoriée et sculptée, laquelle vaut vingt fois plus, au cours actuel des meubles anciens. Mais un de ses parents pauvres la détenait, et il a saisi l'occasion de faire la bonne affaire, à ses dépens et aux miens. Car ce meuble m'appartient toujours, il n'y a pas de révolution qui tienne.
Si je m'étais avisé pourtant de la réclamer à ce ruffian, il m'aurait répondu certainement que « possession vaut titre. »
Nous verrons bien !
Quoique découronné de ses pièces les plus belles et les plus apparentes, le mobilier de Roffignac, où l'utile était mêlé au somptueux, avait de quoi satisfaire encore bien des cupidités et bien des curiosités.
L'administration républicaine en jugea ainsi, espérant que les amateurs se présenteraient aussi nombreux que les acquéreurs des biens-fonds se faisaient rares. Voler un meuble ne semble pas, en effet, aussi coupable ni surtout aussi accusateur que voler un champ. Le meuble se détruit à l'usage, et quand il est usé il n'en est plus question ; un champ reste, au contraire, et le blé qu'il produit chaque année reproche son crime au larron, et ceci à perpétuité.
Le calcul était juste. On commença par le mobilier d'Uzerche. Celui-ci était intact ou semblait intact, car je dirai tout à l'heure ce qu'il y manquait d'essentiel.
Il fut divisé en huit cent soixante lots, sauf légères erreurs dans mes additions,car j'ai la nomenclature sous les yeux et je tiens à être précis. Ces huit cent soixante lots furent adjugés pour la somme totale de 7.083 livres 8 sols 3 deniers.
Cette vente, présidée par le citoyen Roume,semble avoir été effectuée en un seul encan, le 25 mars 1793, ce qui montre à quel point on avait hâte d'en finir avec cette opération véreuse.
Les prix s'en ressentirent. Les acheteurs payant en assignats, et les assignats étant tombés déjà à ce moment à 50 p. 100 de leur valeur nominale, il convient de fixer à 3.500 francs environ la somme réellement perçue par le Trésor.
Quant à l'estimation véritable de tous ces objets, dont la possession allait embellir et empoisonner tant de maisons, on s'en fera une idée quand j'aurai noté que deux fauteuils en bon état et recouverts de velours d'Utrecht furent vendus 8 livres en assignats; et une excellente bergère 10 livres de la même monnaie.
En évaluant à 50.000 francs le prix marchand de notre mobilier meublant d'Uzerche, je crois rester au-dessous de la vérité.
Que de noms on relève dans cette longue liste d'acheteurs, qui seraient étonnés de s'y voir couchés tout vifs ! Mais il me plaît d'être discret.
Il est d'ailleurs probable, qu'un certain nombre d'entre eux, obligés de donner des gages de civisme, avaient, en s'appropriant certains objets, la bonne intention de les rendre plus tard au légitime possesseur et même de s'en faire accroire à ses yeux, au cas où la contre-révolution eût été victorieuse et où M. de Lamase serait revenu en maître.
Mais voilà ! Le contraire s'est produit et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Presque tous ces enchérisseurs ont pensé que ce qui est bon à prendre est bon à garder... et ils ont tout gardé! Peut-être en est-il encore, parmi leurs descendants, qui se couchent dans nos draps et s'essuient avec nos serviettes, tant, dans les anciennes maisons, le linge était abondant et de qualité durable.
Je ne connais, dans l'espèce, que deux cas de restitution.
En 1837, un de mes grands-oncles, accablé par l'âge, désira mourir sinon dans le lit, du moins dans le fac-similé du lit à baldaquin où il était né. Il connaissait le paroissien qui, moyennant 17 livres 10 sols, se l'était approprié et, depuis un demi-siècle, y étendait tous les soirs ses membres maintenant engourdis par la vieillesse.
Mon oncle lui demanda par lettre de permettre à son ébéniste d'en prendre le dessin et la mesure. Le bonhomme, qui était devenu dévot, non par crainte de dieu mais par peur du diable, répondit en envoyant l'objet et ses accessoires, regrettant que tout cela ne fût plus très neuf. J'ajoute qu'il restituait un vieux lit, mais qu'il retenait une terre importante qui n'avait pas vieilli.
En 1910, un pauvre artisan d'Uzerche l'a imité, en rendant spontanément un papier de famille; c'est un diplôme de l'Université de Bordeaux, concernant un de mes ancêtres; ce parchemin n'a aucune valeur, même à mes yeux; le geste ayant été honnête, je tiens à le noter.
L'opération de la vente d'Uzerche s'étant effectuée sans trop de scandale, on procéda à celle de Roffignac, mais celle-ci fut singulièrement plus longue et ne dura pas moins de dix décadis consécutifs.
La valeur en était beaucoup plus importante, tellement importante que le citoyen Lavergne, commissaire du district de Brive, vint s'installer au château pour y diriger l'encan et y vivre grassement aux frais de la princesse, assisté des citoyens Chicou et Deyzat.
Commencées le 1er septembre, les enchères ne furent terminées qu'en décembre et produisirent un total d'environ 50.000 livres en assignats, équivalant à un peu plus de 25.000 en numéraire, ce qui porte la valeur marchande aux alentours de 300.000.
Et une bonne partie de la marchandise avait été abîmée par le passage des barbares.
Les réflexions suggérées par les opérations effectuées à Uzerche s'imposent au sujet de celles d'Allassac. J'userai d'une égale discrétion en ce qui concerne les noms des profiteurs d'occasion, évidemment plus nombreux... cinq ou six cents ! Je ne me permettrai qu'une observation au point de vue de l'art.
Mon arrière-grand-père, jaloux de moderniser Roffignac et de lui imprimer le cachet de distinction alors à la mode, avait orné l'escalier d'honneur d'une rampe magnifique en fer forgé. Ce chef-d'oeuvre était calqué exactement sur la rampe du palais ducal de Nancy qui passait pour une merveille de ferronnerie et qui est réputée de nos jours encore pour une chose remarquable. Les brutes officielles la cassèrent en vingt et un morceaux et la subdivisèrent en autant de lots qu'achetèrent vingt et une autres brutes sans épithète.
Qu'ont-ils fait de ces lots ? Quelques-uns sans doute portèrent les leurs au forgeron qui dut les transformer en instruments aratoires. Mais j'en soupçonne d'autres, déjà messieurs quoique sans-culottes, de les avoir gardés jusqu'à des temps plus calmes pour les revendre à bénéfice, car la belle orfèvrerie de fer a toujours été prisée des connaisseurs.
Je ne dois pas terminer ce rappel de la venté nationale de nos mobiliers sans faire une constatation d'ordre général, car elle s'applique à toutes les rapines du même genre, sur toute la surface du territoire de la république.
Dans les inventaires interminables qui défilent sous mes yeux, je vois bien aligner des lits, des draps, du linge, des fauteuils, des canapés, des chaises, des pots de chambre, des balais, des bahuts, des bois de bibliothèques, des ustensiles de ménage et de cuisine, etc., etc.; je ne vois jamais figurer de bijoux, d'argenterie, de tableaux et de livres précieux. Et Dieu sait si mon arrière-grand-père était fourni de ces objets de luxe, aussi bien d'ailleurs que la plupart des châtelains, des bourgeois et même des campagnards aisés de son temps ! Rien que son argenterie de table représentait une fortune. Et cependant on ne met en vente ni un seul couvert ni un seul plat d'argent. Tout cela est évanoui. L'invasion bestiale des émeutiers de Roffignac a mutilé et brisé des meubles qui se voient, des pendules, des glaces, laissant intacts l'or et l'argent rangés dans des coffres qu'ils ont négligé d'éventrer. Mais à l'invasion des rustres en blouse et en sabots ont succédé plusieurs invasions de gens bien mis et bien chaussés, qui, sous prétexte d'apposition de scellés ou de formalités d'inventaires, ont clandestinement pénétré dans les riches demeures, fracturant les serrures et emportant le solide; tout ce qui, sous un volume médiocre, représente la forte somme réalisable à toute heure et dont personne ne s'avise de demander compte. Ils laissent les miettes du festin au menu peuple, fabriquent ainsi des milliers de complices et, grossissent la responsabilité de ces complices, dans le but de les déterminer à persister à jamais dans l'hérésie révolutionnaire ; ils se dissimulent dans l'ombre et s'emparent de l'or et de l'argent, sûrs que la possession de ces métaux les mettra à l'abri des réclamations futures; car l'argent ni l'or ne portent avec eux la marque du possesseur légitime, ou, s'ils la portent, il est facile de l'effacer.
Ce phénomène, encore une fois, s'est produit partout, d'abord secrètement, puis ouvertement, à la face du soleil. Les grands guillotineurs forcent les détenteurs de numéraire et d'orfèvrerie à les déposer, sans reçu, entre leurs mains. Ils volent les calices et les ciboires des églises, brûlent les chapes sacerdotales pour en extraire les fils précieux.
Fouché, après son proconsulat de Nevers, entasse les produits métalliques de ses exploits dans quatre fourgons qu'il expédie tranquillement vers sa maison de Paris. Lequinio fait faire des perquisitions domiciliaires à Rochefort et remplit trois tonnes d'écus de six livres, qui constituent ses petits profits. On verra plus loin qu'on allait jusqu'à fouiller dans les poches pour en extraire la monnaie.
Cette raréfaction de l'or et de l'argent, opérée par les chefs de la révolution et à leur avantage exclusif, produisait fatalement la disette, laquelle occasionnait les accaparements du blé et, finalement, déterminait la banqueroute. Ces trois dénouements, faciles à prévoir, devaient être trois nouvelles sources de lucre pour les bandits. Ils les escomptaient, et ce calcul odieux n'est pas un des côtés les moins intéressants de la philosophie révolutionnaire.
La France, on ne saurait trop insister sur cette vérité, possédait cinq milliards de métaux d'échange en 1789, beaucoup plus proportionnellement qu'aujourd'hui, étant donnés les besoins décuplés du commerce. La moitié de ce trésor national était monnayée; l'autre était convertie en objets d'art. Cette joaillerie était la réserve de la France, car, dans un besoin pressant de l'Etat, ses détenteurs n'hésitaient jamais à la porter au trésor public pour y être traduite en numéraire.
La révolution n'avait pas sévi trois ans qu'il ne circulait plus en France une seule pièce d'or et d'argent, et qu'on ne mangeait plus que dans des assiettes de faïence avec des fourchettes de fer.
Les divers hôtels des Monnaies, autrefois et depuis si actifs, tombèrent en sommeil comme les Loges. C'est à peine s'il a été frappé, de 1790 à 1801, pour quinze millions de numéraire jaune et blanc. La frappe du billon, dont la valeur intrinsèque est insignifiante, fut seule intarissable, comme l'impression des assignats.
Où avaient donc passé ces cinq milliards ? Evidemment dans les poches des chefs de la conspiration.
Aussitôt l'ordre matériel rétabli et la Banque de France instituée, on vit s'engouffrer dans ce réservoir national tous les métaux précieux naguère introuvables. Après les avoir liquidés les fripons éprouvaient le besoin de les solidifier à nouveau ("Sarepta dicitur Gallia, ubi metallis rapiendis et liquandis" Exégèse rabbinique de la Bible). Si, de 1790 à 1802, la Monnaie n'a fabriqué que quinze millions de pièces métalliques, elle en a jeté en circulation pour plus de quatre milliards dans les dix années qui suivent.
Il semble bien que voler soit le propre de l'homme, presque autant que forniquer. Il faut une grande vertu naturelle et beaucoup de religion pour résister à la tentation de pratiquer ces deux vices, quand le diable les présente dénués de danger et abrités contre la honte.
En 1793 vertu et religion étaient également bafouées.
Quand les gens demi-honnêtes eurent compris qu'on pouvait, en prenant quelques précautions légales, s'approprier le mobilier d'autrui, sans éprouver de trop cuisants remords et sans être montrés au doigt par le voisin aussi peu innocent qu'eux-mêmes, ils estimèrent que la prise de possession des maisons et des terres du prochain ne tirerait pas beaucoup plus à conséquence.
Il se présenta donc des acquéreurs pour concourir aux adjudications des biens-fonds.
On avait vite renoncé à former des lots considérables auxquels seuls auraient pu prétendre les gros bonnets du pays, du moins ceux qui ne refusaient point de se déshonorer mais prétendaient y mettre des formes.
Il convenait donc de laisser les paysans s'engager les premiers dans cette opération malhonnête. Ils en auraient la honte et, plus tard, on s'arrangerait pour racheter leurs petites parcelles, d'autant plus aisément que les cahiers des charges contenaient une clause de rescission de vente en cas de non-paiement dans les délais stipulés. En outre, il fallait payer comptant le premier dixième de l'adjudication; c'était un moyen de vider à fond les bas de laine des cultivateurs et de « liquider » tous les métaux de France, jusqu'au dernier louis, jusqu'au dernier écu de six livres, conformément au programme.
D'ailleurs, le conventionnel Cambon, le receleur en chef de tous les biens volés, criait misère. Les biens, dits nationaux, étaient les gages des assignats et les assignats baissaient, baissaient toujours.
La Convention ordonna alors de diviser les latifundia en plusieurs lots, de vendre chaque parcelle à n'importe quel prix et d'accorder aux acheteurs de grandes facilités de paiement.
En ce qui concerne les domaines de mon arrière-grand-père, les administrateurs de la Corrèze décidèrent qu'il serait politique de commencer par la mise en vente d'une vaste prairie qui s'étendait au pied de sa maison patrimoniale d'Uzerche, et qui, par sa situation en contre-bas des anciens remparts, était d'une fécondité rare. Constamment arrosée par la Vézère et engraissée par les eaux de la ville, elle excitait la convoitise des sans-culottes peu délicats.
La prairie, d'une contenance de 24.800 toises carrées d'après l'inventaire officiel, c'est-à dire de dix hectares environ, fut divisée en huit lots.
Sept furent vendus le 19 ventôse de l'an II, ce qui correspond au 9 mars 1794.
Oh ! par cher. Cette propriété, qui vaut certainement aujourd'hui plus de 100.000 fr. en bloc, pouvait être évaluée à cette époque 60.000 livres. Elle fut cédée aux amateurs pour le prix de 15.925 fr.
Un peu plus du quart, dira-t-on. Il est donc exagéré de prétendre que les biens nationaux ont perdu sur le marché 95 p. 100 de leur valeur.
Attendez ! Le prix de 15.925 francs existe bien sur le papier officiel, mais la somme effectivement versée au Trésor fut réduite au chiffre plus modeste de 1.218 fr. 55. La dépréciation réelle subie par notre prairie d'Uzerche fut donc de 98 p. 100.
Par quel miracle d'opération mathématique et de rouerie fiscale en est-on arrivé à ce résultat fantastique ?
Oh ! bien simple. Les acquéreurs avaient la faculté de se libérer en assignats reçus à leur taux nominal, et ils en usaient avec d'autant plus d'enthousiasme que l'assignat était déjà tombé au commencement de 1794 à 40 p. 100 de sa valeur fiduciaire ; mais ils avaient aussi le droit d'anticiper les payements fixés à dix échéances annuelles, toutes égales.
Ils en usèrent de même ; cependant ce ne fut point par excès de zèle.
Je prends comme exemple l'individu qui se rendit adjudicataire du lot n° 1 au prix officiel de 2.400 francs. Le jour de l'enchère il versa deux cent quarante livres en assignats, soit quatre-vingt-dix francs convertis en numéraire. L'année suivante, cent francs d'assignats ne valaient plus que vingt francs. Il donna encore deux cent quarante livres, soit cinquante francs en numéraire. Au commencement de 1796, la troisième année de l'acquisition, un vent de ruine soufflait sur toute la France. On achetait couramment mille livres en assignats avec un louis d'or authentique ou avec quatre écus de six livres.
Tous les acheteurs du pré Lamase jugèrent le moment favorable pour anticiper les payements. Ils acquittèrent huit annuités d'avance. L'adjudicataire du premier lot paya donc les 1.920 francs qu'il devait encore en monnaie de singe, je veux dire avec huit ou dix écus de six livres, en sorte que sa nouvelle propriété, si elle lui coûta son honneur et peut-être le salut de son âme, ne l'appauvrit que de 161 fr. 55, pas même la valeur de la moitié d'une récolte de foin.
Cette spéculation était à la portée de toutes les intelligences. Parmi les soixante-dix à quatre-vingts voleurs de nos immeubles je n'en ai remarqué qu'un seul n'ayant pas su profiter de l'occasion. C'était un sot qui paya cher sa sottise. En effet, vers la fin de 1796, les grands chefs de la révolution, ayant jugé que la vaste escroquerie des assignats avait procuré le maximum de profit qu'ils pouvaient raisonnablement en attendre, décrétèrent leur première banqueroute. Disqualifiant eux-mêmes les quarante-sept milliards de petits papiers revêtus de leurs signatures, ils décidèrent que ceux-ci ne seraient plus reçus, à aucun taux, dans aucune caisse publique. Il fallut payer en numéraire et bon nombre d'acheteurs de biens nationaux en étant démunis furent déchus de leur acquisition. Le vol leur coûta au lieu de leur rapporter, et beaucoup de paysans apprirent à leurs dépens qu'il en cuit parfois de s'acoquiner avec les fripons des villes.
Les bourgeois et les gentilshommes dévoyés attendaient ce moment-là pour reprendre, à meilleur marché encore qu'en 1793 et 94, les parcelles qu'on avait abandonnées aux miséreux et arrondir les gros lots dont ils étaient déjà nantis. Ce mouvement tournant et enveloppant leur fut facilité par le gouvernement du Directoire qui décida dès lors qu'on ne mettrait plus les biens nationaux aux enchères mais qu'on les céderait de gré à gré.
On peut imaginer la nouvelle gabegie à laquelle donna lieu cette mesure.
Voici pourquoi les latifundia, qu'on ne voulait plus souffrir aux mains des nobles, se reconstituèrent entre les griffes des clercs d'huissiers, hommes de loi, secrétaires de mairie, magisters de villages, prêtres défroqués et autres espèces qui composèrent l'immense majorité des gros acheteurs, et dont quelques-uns ont fait souche d'honnêtes gens, défenseurs du trône, de l'autel, surtout partisans irréductibles du principe sacro-saint de la propriété. Leurs descendants croiraient manquer à toutes les traditions de la chevalerie s'ils n'ornaient point leurs noms de la particule, s'ils ne le flanquaient point même parfois d'un titre ronflant.
Cette note historique et philosophique m'a éloigné un peu du sujet principal du chapitre. Aussi bien, dois-je supposer que les digressions de cette nature offrent un intérêt plus général que la nomenclature un peu sèche des biens ravis, alors même que j'imprimerais tout vifs les noms des personnages qui ne rougirent pas de s'enrichir de ces dépouilles, noms qui sont au bout de ma plume mais qui n'en sortiront pas encore. Il me suffit, pour l'instant, de troubler leurs héritiers dans une possession... moralement irrégulière.
Je me suis étendu assez longuement sur la vente de la prairie d'Uzerche, afin de mettre à nu les procédés de liquidation de l'époque révolutionnaire, et pour expliquer pourquoi l'immense vol des biens nationaux ne constitua finalement qu'une opération financière des plus médiocres. Cinq cent quarante millions seulement sont tombés dans les poches du détrousseur en chef, Cambon, et l'on estime à vingt-cinq milliards la valeur marchande des propriétés qui furent confisquées, soit huit milliards au clergé tant régulier que séculier, quinze milliards aux émigrés et deux milliards aux décapités. Cela fait à peine du 3 p. 100, moins que les brocanteurs louches ne donnent aux cambrioleurs et moins que les banqueroutiers frauduleux qui se respectent, après fortune faite, n'attribuent à leurs clients.
Il semble d'ailleurs que ce soit un prix fait. Le milliard des congrégations, je l'ai dit dans la préface, ne produit que trente millions, soit 3 p. 100 de l'estimation, et les prolétaires septuagénaires n'en tirent pas plus de profit que les pauvres de 93 n'ont tiré de revenant-bon de la spoliation des nobles et des prêtres. C'est le métier des déshérités de la fortune d'être toujours dupes.
Si le pré Lamase n'a procuré que 1.218 fr. 55 net au Trésor, la belle terre de Roffignac a rapporté moins encore proportionnellement. En 1789, elle était estimée un million environ. Sa valeur s'est beaucoup accrue depuis, tant à cause de la bonification de la culture qu'en raison de l'exploitation d'ardoisières d'un excellent rapport (Ces ardoisières sont exploitées par une société en actions, en sorte qu'un nombre notable de mes compatriotes se partagent nos trésors souterrains. On trouve parmi les actionnaires, non seulement la quantité mais parfois aussi la qualité, je veux dire certains noms qu'on aimerait autant ne pas rencontrer sur la liste). Jusqu'en 1796 c'est à peine si l'on en avait détaché quelques lambeaux, achetés par des paysans ambitieux d'agrandir le champ dont ils étaient riverains. En 1795 on divisa le bloc en quatre lots qui furent acquis par trois petits bourgeois d'Allassac et un ancien valet de chambre du château. Celui-ci consacra à l'accomplissement de sa mauvaise action les économies de ses gages; ce qui constitua un placement avantageux, car ses descendants vivent encore sur la terre plantureuse acquise ainsi par l'ancêtre, en bons rentiers, craignant Dieu et les gendarmes. Je respecte leur quiétude en ne les nommant pas. Par charité je tais aussi le nom de ses trois camarades qui expièrent, de leur vivant, par des fins lamentables, leur faute jugée par Dieu impardonnable en ce monde.
Les quatre gros lots et les petits furent adjugés au prix global de 252.000 livres, payées sur-le-champ ou en deux termes, avec des assignats valant un louis les mille livres, — mettons deux pour faire bonne mesure — ce qui ramène la somme versée au Trésor au maximum de dix ou douze mille livres — un peu plus de 1 p. 100.
La terre de Vignols fut divisée en neuf lots. L'un d'eux fut généreusement abandonné à mon grand-père qui, n'ayant pas émigré, avait droit au quart des biens de son père, c'est-à-dire au septième du quart, puisqu'il ne représentait qu'un septième de la descendance. Mais on lui rogna quand même ce vingt-huitième de portion. Après ventilation, il n'obtint qu'une maison d'habitation et une quinzaine d'hectares de prés, terres, bois et vignes. Il dut s'en contenter, car il y allait de la vie de protester, et j'ignore s'il ne fut pas même contraint de dire merci! Coûte que coûte, il importait de sauver du naufrage universel ce lopin de l'héritage des Maulmont, l'illustre famille qui a eu l'honneur de donner deux papes à l'Église, Clément VI et Grégoire XI.
Les terres possédées sur le territoire de la ville d'Uzerche, y compris la prairie Lamase, furent adjugées au prix total de 262.000 livres, qui rapportèrent à Cambon dans les trente mille francs ; ce qui fait presque du 9 p. 100 sur l'adjudication; mais pour obtenir la valeur réelle il faut, comme dans les autres cas, multiplier 262.000 par 4.
Dans la commune de Vigeois, huit cents hectares environ, subdivisés en vingt-cinq ou vingt-six domaines et constituant cinq seigneuries, Roupeyroux, Haute et Basse-Mase, Charliac, Charliaguet et La Nauche évitèrent le morcellement à l'infini. Il semble que chacune de ces propriétés ait été adjugée à un seul enchérisseur, et les prix atteints furent relativement élevés. C'est ainsi qu'on paya la Haute-Mase 31.000 livres et la Basse-Mase 32.000. La Nauche fut adjugée à un métayer, nommé Lacroix, qui emprunta à un usurier l'argent qu'il jugeait utile à la faisance-valoir. Au bout de deux ans le prêteur le fit exproprier, et Lacroix, sans ressources, se fit bandit et coupeur de routes, estimant ce métier plus honorable que celui de voleur de biens. Les gendarmes le massacrèrent dans un chemin creux, en 1799, au cours d'une de ses expéditions nocturnes. Un des domaines de Charliac fut laissé à mon grand-père, soit disant pour compléter, avec les quinze hectares de Vignols, la part de sa légitime.
Le reste de la propriété de Charliac fut morcelé, mais les divers acquéreurs subirent, plus ou moins, la fâcheuse destinée de Lacroix. Leurs premiers successeurs ne furent pas plus heureux. Quand les drames parurent oubliés, un spéculateur patient fit masse de tous les morceaux et en constitua, en les joignant à la terre et au château de la Nauche, une des plus belles propriétés du pays.
Le Roupeyroux fut adjugé à un ancien huissier, le nommé B..., celui-là même qui a rendu en 1837 le lit à baldaquin. Il l'a transmis à ses enfants et c'est maintenant son petit-gendre qui l'occupe, quand il n'occupe pas au tribunal.
Le domaine de Fleyniat à Lagraulière fut adjugé au prix officiel de 25.000 livres. Les beaux et nombreux domaines de Perpezac-le-Blanc, de Perpezac-le-Noir, d'Orgnac, de Voutezac, du Lonzac, etc., furent vendus à des aigrefins dont j'ai la liste (Un des acquéreurs, sans le sou, se porta adjudicataire d'un domaine pour le prix de 30.000 livres. II courut à sa nouvelle propriété, en détacha une paire de boeufs et s'empressa de les vendre à la foire voisine au prix de 40.000 livres en assignats. Il en donna 30.000 au fisc, et avec le reste acheta deux veaux. Je défie bien les apologistes les plus déterminés de la révolution de démontrer qu'une propriété constituée de cette façon repose sur des bases inébranlables.).
Je me dispense de la divulguer; mais j'exprime un regret cuisant en songeant à la perte de la terre de Montéruc, au demeurant d'assez mince valeur. Elle nous venait des Roffignac qui la tenaient eux-mêmes, par suite de trois alliances consécutives, du cardinal Aubert de Montéruc, neveu du pape Pierre Aubert des Monts, connu dans l'histoire sous le nom d'Innocent VI (1352-1362) (Si Montéruc n'avait pas grande importance, en tant que terre régie par le seigneur, elle en avait une inappréciable par le nombre des redevances auxquelles étaient astreints les habitants du pays. Je n'ai pas compté moins de trois cents de ces tributaires, payant qui une géline, qui une douzaine d'oeufs, ou une gerbe de blé ou une gerle de vin, etc. Ces redevances ou servitudes provenaient de ventes régulières ou de donations à titre légèrement onéreux; elles servaient à maintenir un lien très ténu mais indéchirable entre le maître primitif et les familles de ses anciens tenanciers ; c'était un rappel de propriété. En détruisant tous ces titres dans la fatale nuit du 4 août, l'Assemblée Constituante a donc commis un attentat contre le bien d'autrui, premier crime qui a facilité les autres.).
Avant de clore ce chapitre des spoliations, il est juste de consacrer quelques pages à la destinée du château de Roffignac, dont les conjurés du Bas-Limousin ne pouvaient considérer l'aspect majestueux sans qu'une basse envie ne pénétrât leurs âmes cupides et n'échauffât la haine qu'ils avaient vouée au châtelain.
Aucun cependant n'avait osé l'acheter pour s'y prélasser en maître. Même aux heures de complet bouleversement et de travestissement de toutes les conditions sociales, les usurpateurs les plus osés reculent devant certains ridicules.
En sus des quatre gros lots du bloc domanial, il existait une réserve assez importante entourant la demeure seigneuriale. L'administration de l'enregistrement l'avait affermée à un sans-culotte qui était, en même temps, un sans-soutane, car c'était un prêtre défroqué (J'ai longtemps cru que ce malheureux était le curé d'Allassac, mais des renseignements plus précis m'ont appris qu'il était curé d'une paroisse voisine où nous avions aussi des biens. Le scandale reste d'ailleurs le même.).
Cet apostat y faisait bombance tandis qu'une affreuse disette sévissait sur toute la contrée, et il s'efforçait de donner tous les jours des gages de plus en plus irrécusables de son sans-culottisme. Les novices du crime ont toujours peur de n'y être point enfoncés assez profondément pour étouffer leur conscience et pour donner aux professionnels des preuves suffisantes de leur sincérité. Ce double sentiment explique pourquoi les plus forcenés terroristes furent généralement des prêtres ou des ex-dévots.
Le spectre du vieil exilé, dont il dévorait audacieusement les revenus, hantait ses rêves. Il lui aurait volontiers fait couper le cou, mais la victime était hors de portée. Ne pouvant lui prendre la tête, il résolut de s'en prendre à son château et de détruire ainsi une demeure de gens de bien.
La démolition de Roffignac ne pouvait rien rapporter à personne. Le peuple criait la faim : on lui offrait des pierres. Il paraît que le système a du bon puisqu'il réussit encore quelquefois.
Quand l'ex-curé proposa à la municipalité de la commune d'Allassac de découronner le château, celle-ci fut choquée qu'il prît une initiative aussi radicale. L'apostat menaça alors les officiers municipaux de porter contre eux une accusation de modérantisme. Epouvantés, ils le supplièrent de faire du moins les choses régulièrement, de présenter une requête officielle sur laquelle ils prendraient une délibération conforme à ses désirs. Le déprêtrisé s'exécuta, mais comme c'était un prévoyant de l'avenir le texte de sa pétition a totalement disparu.
Il reste pourtant les procès-verbaux des actes officiels auxquels donna lieu ce document.
C'est d'abord le récit des événements qui provoquèrent la première réunion du conseil municipal d'Allassac :
La pétition avait été transmise par l'intermédiaire de deux jacobins de la commune et renvoyée à une commission; mais sans attendre que la municipalité eût statué sur sa demande, l'apostat avait ameuté deux fois le peuple, et le peuple avait menacé de procéder sans autorisation à la démolition. On l'avait calmé en le « pérorant », et en promettant d'envoyer sur-le-champ deux commissaires à Brive, chargés de solliciter des administrateurs du district, « seuls investis du pouvoir d'ordonner la destruction d'un bien national, la permission d'abattre Roffignac ».
Manifestement, les officiers municipaux ne cherchaient qu'à gagner du temps. Mais ils n'avaient pas eu la main heureuse dans le choix des commissaires expédiés au district de Brive. L'un de ceux-ci, fesse-mathieu de la localité, était capable de marcher sur le cadavre de son père pour parvenir à faire parler de lui.
Les bruits les plus sinistres couraient sur l'autre, tout jeune homme, étranger au pays. Il y était apparu depuis six mois à peine, amené de très loin par un marchand roulier qui, le sachant réfractaire à la conscription, l'avait caché dans le chenil de sa carriole pour le dérober aux recherches des gendarmes. On assurait que, levantin d'origine et conduit en France par un officier de marine qui l'avait fait instruire, il avait livré son libérateur au bourreau. Audacieux et bavard intarissable, il n'avait pas tardé à prendre la tête des sans-culottes du pays, et les honnêtes gens le redoutaient.
La municipalité d'Allassac lui avait donné, ainsi qu'à son collègue, l'instruction secrète de rapporter à tout prix un arrêté du district de Brive prescrivant de surseoir indéfiniment à la démolition du château.
Par la lecture de l'arrêté qui suit on va voir comment les deux drôles s'étaient acquittés de cette mission de confiance.
Je passe sur les préliminaires, rappelant la pétition du mauvais prêtre R...
"L'administration du district, n'entendant pas contrarier la voix du peuple pour la démolition du cy-devant château de Roffignac, déclare recommander à la loyauté du peuple de la Commune d'Allassac la conservation du mobilier et des denrées, tant en vins qu'en grains, qui sont dans les bâtiments de ce cy-devant château, dont le peuple serait responsable tant collectivement qu'individuellement, en cas de dilapidation ou dégradation; sous la même responsabilité, de pourvoir à la sûreté des dits objets, soit par le moyen des scellés sur les portes des bâtiments qui les contiennent, s'ils ne doivent pas être démolis, soit par le déplacement, s'il y a lieu, après en avoir préalablement constaté les quantités et qualités par un procès-verbal énumératif régulièrement fait, avec recommandation expresse à la dite municipalité de prendre toutes les autres mesures de précaution que sa prudence lui suggérera suivant les circonstances, pour la conservation des dits objets.
Fait au conseil d'administration du district de Brive, le 1er germinal, an II, de la Rép. fr., une et indivisible.
Suivent cinq signatures."
Il n'y avait plus qu'à s'exécuter et, dès le lendemain, la municipalité d'Allassac faisait procéder à la nomenclature du mobilier restant encore dans le château.
Cet inventaire n'offre point par lui-même grand intérêt ; il témoigne seulement de l'inquiétude des malheureux obligés de le dresser et des précautions qu'ils prennent pour accroître, le plus possible, le nombre des responsables. Neuf signatures, en effet, sont apposées au bas de ce long document, et l'une d'elles a même été, ultérieurement, grattée frénétiquement. A ces neuf noms sont ajoutés ceux de douze commissaires désignés pour surveiller les travaux de la démolition et prendre garde que les matériaux ne soient point détériorés. Tout le long du papier, ces infortunés officiers municipaux protestent qu'ils agissent ainsi à leur corps défendant.
La destruction méthodique dura quatorze jours, du 4 au 18 germinal de l'an II. La population, que les citoyens R... et X... avaient représentée comme désireuse d'accomplir au plus vite cet acte de vandalisme, fit preuve, au contraire, d'une remarquable tiédeur, et il fallut menacer les paysans poulies forcer à coopérer à l'enlèvement gratuit et obligatoire de pierres qui ne serviraient plus à rien. Beaucoup se demandaient si c'était pour aboutir à pareil résultat qu'on avait supprimé la corvée avec tant de fracas (la corvée avait été abolie en Limousin par Turgot, dès 1761 ; elle le fut également pour toute la France en 1789, non seulement la corvée seigneuriale mais encore la corvée publique, autrement dite « prestation ». Elle fut rétablie le 20 prairial an II, sous le nom de réquisition, et dans les conditions les plus abusives, puisque les citoyens furent contraints de travailler les uns pour les autres, sous peine de déportation).
Les tyranneaux des départements trouvèrent moyen d'exaspérer encore l'arbitraire de la Convention. J'ai sous les yeux une circulaire des administrateurs d'Uzerche adressée par eux à tous les maires du district en leur transmettant le décret du 20 prairial. A la peine de déportation édictée par la Convention contre les ouvriers agricoles qui se déroberaient à l'obligation de la corvée, ils substituent, de leur propre autorité, la menace de la guillotine, et ce n'était point un vain épouvantail ; le men-
Enfin la partie du château condamnée à mort était tombée le 18 germinal, comme le constate une pièce officielle datée de ce jour et revêtue de la signature du maire et de deux de ses officiers municipaux. Le défroqué requis de signer également s'y refusa avec énergie. Ce n'était pas seulement un misérable, c'était un roué. On ne peut rien invoquer contre une signature authentique, mais on peut toujours nier avoir participé à un acte criminel quand la culpabilité ne laisse pas de témoignages décisifs.
Toujours harcelé par l'esprit de prudence, il ne voulait pas se rendre acquéreur des restes du château et des jardins, quoiqu'on lui offrit le tout à vil prix. Cependant; il fallait que le décret des Loges fût exécuté. Mes parents, quoi qu'il advînt, ne devaient pas rentrer en maîtres dans leur vieille demeure, même en ruinés, et c'est pour cette raison — rien que pour cette raison — qu'on les fit languir dix-huit mois à Paris.
Un petit bourgeois d'Allassac se laissa tenter, en 1802, par l'esprit de Spéculation.
Il morcela les terrains aplanis par la démolition de germinal, an II, ainsi que les beaux jardins escarpés qui grimpaient jusqu'au mur d'enceinte de là petite ville. On a construit sur ces emplacements des masures, maintenant lamentables de vétusté;
Le corps du château, en dépit de son émasculation vandalique, gardait encore belle apparence avec sa tour carrée centrale décapitée, abritant à droite et à gauche deux corps de logis.
N'en pouvant rien tirer et n'osant l'habiter de peur d'être l'objet des moqueries de ses concitoyens, le premier spéculateur le céda à un second.
Celui-ci emprunta de l'argent à un homme qui avait le plus grand intérêt moral à faire disparaître les derniers témoins muets de ses hypocrisies d'antan.
Cet homme n'eut garde de faire exproprier son débiteur, mais il avait assez d'influence sur le conseil municipal pour le déterminer à acheter le monument, sous le prétexte de bâtir une maison d'école. Le marché fut conclu. Le créancier commença naturellement par se rembourser avec les deniers publics; puis Roffignac fut rasé et la maison d'école, telle qu'on la voit encore aujourd'hui, a été construite sur les fondements du château.
En l'édifiant on avait évité, par motif d'économie, de défoncer les caves voûtées qui témoignaient toujours de l'importance et de la solidité des antiques constructions.
En 1897, la municipalité d'Allassac, composée d'ailleurs de braves gens, gênée par ces voûtes pour ses opérations de voirie, en décréta l'effondrement ainsi que la suppression d'une porte gothique, dernier reste des fortifications de la petite ville.
...etiam periere ruinae.
Il n'y a plus rien !... rien de ce Roffignac qui fut, suivant les traditions les mieux accréditées, le berceau du christianisme dans les Gaules; qui aurait abrité saint Martial; qui, sûrement, a donné l'hospitalité au pape Innocent VI, à quatre rois de France, au duc d'Anjou, vainqueur de Jarnac et de Moncontour, à Henri IV, au duc de Bouillon et à son illustre fils, le maréchal de Turenne, à nombre d'autres personnages éminents;... qui avait étendu, à travers les siècles, son ombre bienfaisante sur toute la contrée.
Il existe encore à Allassac une grosse tour ronde ayant toujours dépendu du fief seigneurial. Edifiée par Pépin le Bref, lors de ses guerres contre les aquitains, elle est d'une allure imposante et constitue un beau joyau pour son propriétaire, — sans utilité pratique d'ailleurs.
Elle n'avait pas été vendue et, depuis 1814 jusqu'en 1846 environ, mon grand-père et ses frères avaient exigé de la ville d'Allassac un fermage de deux francs, établissant leur droit de propriété et interrompant la prescription. A cette dernière date, le maire du lieu, sous couleur d'ardente amitié, confia à mon père, avec des tremblements dans la voix, qu'il aurait la douleur de lui faire un procès au nom de la commune, s'il ne renonçait pas à sa rente de quarante sous. Mon père, qui n'était pas processif, céda.
Je fais mention de cette tour parce que les voyageurs la remarquent dans le trajet du chemin de fer de Paris à Toulouse, dominant la plaine, et parce que je ne dois rien oublier de nos revendications.
On l'avait rendue à mon arrière-grand-père, après le décret d'amnistie de 1802, mais il n'en pouvait rien faire.
On lui avait aussi rendu sa maison d'Uzerche, mais dans quel état ?
Diminuée des trois quarts comme son château de Roffignac. Pendant la période jacobine, l'administration d'Uzerche avait, elle aussi, pris un arrêté prescrivant de la démolir sous prétexte qu'elle affectait les allures d'une forteresse et qu'elle flanquait la porte « Pradel », ce qui constituait évidemment une double injure à la liberté.
Ce qu'on voit maintenant de notre vieille demeure ne représente pas même l'ombre de son aspect d'autrefois, quand elle était rapprochée du mur d'enceinte, ornée de tours à ses quatre angles, entourée de murs et de fossés, rendant l'accès de la ville presque impraticable à l'ennemi.
Il est extrêmement probable qu'elle avait été bâtie par mon premier ancêtre limousin, Géraud ; son style architectural est indiscutablement du quinzième siècle, comme on peut s'en assurer par la photographie publiée ci-contre, qui reproduit une gravure ancienne conservée à la mairie d'Uzerche.
La partie de la maison laissée debout, et servant autrefois de communs, avait été convertie en prison où l'on entassa, sous la Terreur, les femmes suspectes du district, et Dieu sait si elles étaient nombreuses !
C'est à cause de cette particularité qu'elle n'avait pas été mise en vente et qu'elle fit retour à son légitime possesseur, mais aussi nue qu'au jour lointain où le maître « ès-art maconnerie » l'avait livrée à son premier propriétaire.
Impossible en 1802 d'acheter des meubles, faute d'argent; donc, impossible de l'habiter.
Mes parents furent réduits à accepter l'hospitalité de l'un de leurs proches.
Ces deux vieillards, qui avaient été les rois de leur pays, rois par l'opulence et la dignité de leur vie, rentrèrent chez eux dénués des ressources les plus élémentaires. La révolution les avait contraints à cette détresse, parce qu'ils auraient commis le crime d'émigration, inexistant en droit pur et rayé expressément du code au mois de septembre 1791.
Le plus étrange, c'est que ce crime, même entendu et interprété dans le sens le plus révolutionnaire, mon arrière-grand-père ne l'a jamais commis.
Titre : Le Pillage des biens nationaux. Une Famille française sous la Révolution
Auteur : Pradel de Lamase, Paul de (1849-1936)
Éditeur : Perrin (Paris)
Date d'édition : 1912


Né en 1913 et mort en 2008 en Martinique, Aimé Césaire fut poète, dramaturge et homme politique. Anticolonialiste résolu, il a notamment élaboré, avec Léopold Sédar Senghor, la notion de « négritude ». Son ouvre littéraire est aujourd'hui mondialement reconnue et saluée.

5e série, no 13, p. 249-251
1926
La vente des biens nationaux en Belgique
Malgré son intérêt primordial pour l’histoire économique et sociale de la période contemporaine, la vente des biens nationaux n’a pas encore été étudiée en Belgique de façon scientifique. Seuls les historiens locaux lui ont consacré quelque attention. On ne possède donc sur elle que des données fragmentaires et éparpillées. Il serait grand temps de la soumettre à une enquête approfondie et méthodique.
Le fait que les Archives de l’État ne renferment pas les archives administratives postérieurement à la conquête française constitue un obstacle considérable à l’entreprise d’une enquête de ce genre. Les papiers et les registres concernant les ventes se trouvent, en effet, confiés aux gouvernements provinciaux, qui ne possèdent pas, en général, le personnel nécessaire à leur inventaire et à leur communication aux travailleurs. Depuis ces derniers temps cependant quelques gouverneurs ont pris l’initiative heureuse de les verser aux dépôts de l’État, et il faut espérer que leur exemple se généralisera.
Je tiens à faire observer en passant que les documents relatifs à la vente des biens nationaux devraient attirer l’attention des médiévistes. Les précisions qu’ils fournissent sur l’étendue et la répartition des biens ecclésiastiques sont de nature à faciliter singulièrement les recherches relatives à l’organisation domaniale des abbayes et des établissements religieux, sur laquelle les actes du Moyen-âge ne nous donnent en général que des renseignements qu’il est difficile de réduire en chiffres. La confection rapide et la belle tenue des registres font d’autant plus honneur aux agents français qui les ont dressés, que les municipalités du pays mettaient une mauvaise volonté, bien compréhensible, à leur fournir les renseignements demandés.
Ma communication n’a d’autre but que d’attirer l’attention sur une question trop négligée. Je me hâte de dire que je me suis borné à jeter un coup d’œil rapide sur une très petite partie des sources. Amené à m’occuper des ventes lors de la rédaction du tome VI de mon Histoire de Belgique, actuellement sous presse, force m’a donc été, vu l’absence de tous travaux antérieurs, de prendre directement contact avec les documents. La plupart de ceux que j’ai vus concernent le département de l’Escaut, c’est-à-dire la province actuelle de la Flandre orientale. Encore ne les ai-je pas soumis, faute de temps, à une investigation exhaustive. Je n’apporte donc ici qu’une simple impression qui peut-être serait très différente de ce qu’elle est, si j’avais pu consulter des actes plus nombreux et concernant une région plus étendue.
Un fait à relever tout d’abord, c’est la date assez tardive des ventes en Belgique. Elles ne commencent qu’à la fin de 1796, c’est-à-dire après la promulgation, dans les neuf départements réunis, de la loi supprimant les corporations religieuses et autres. Il est vrai qu’il y a eu des ventes dès 1794, mais elles ne s’appliquent, à ce moment, qu’aux biens possédés en Belgique par des établissements ecclésiastiques ou par des émigrés de nationalité française.
Les biens d’origine belge vendus depuis 1796 sont presque exclusivement des biens ecclésiastiques ou, suivant l’expression populaire, des « biens noirs ». On trouve seulement, à côté d’eux, quelques bâtiments et quelques pièces de terre de minime importance ayant appartenu à des corporations de métiers, à des chambres de rhétorique, à des confréries civiles, ou au gouvernement autrichien. Les actes que j’ai vus ne mentionnent pas, ou mentionnent à peine des biens d’émigrés. Ceci se comprend quand on constate que l’émigration proprement dite n’a pas existé en Belgique. Les nobles et les propriétaires qui avaient quitté le pays en 1794 sont presque tous rentrés de très bonne heure. Pratiquement donc, le transfert de capital mobilier produit par les ventes n’a porté que sur les domaines de l’Église, c’est-à-dire sur environ un quart de l’étendue du territoire.
Au début, les acheteurs sont surtout d’anciens moines utilisant les bons qu’ils ont reçus du gouvernement républicain au moment de leur sécularisation, à l’acquisition des terres, que la plupart d’entre eux se proposent de restituer plus tard. On trouve ensuite des notaires ou des hommes d’affaires agissant comme intermédiaires pour des clients anonymes, et enfin des spéculateurs étrangers : la compagnie Paulée, de Paris, des gens du département du Nord, des Suisses de Genève, de Berne, de Lausanne, des habitants d’Amsterdam, etc. Les paysans paraissent s’être abstenus complètement. La cause de cette abstention doit être cherchée sans contredit dans les scrupules religieux qui les empêchèrent de s’approprier des terres dont la confiscation leur apparaissait comme une monstrueuse impiété. L’ascendant que le clergé exerçait sur eux explique suffisamment leur abstention. Elle ne peut guère provenir de leur incapacité d’acheter, car, dans les premiers temps au moins, les ventes se firent à vil prix et tout porte à croire que la population rurale, enrichie par la vente des denrées après la crise économique terrible qui avait suivi la bataille de Fleurus, possédait des économies assez abondantes. La signature du Concordat diminua certainement la réprobation des paysans. Mais alors, il était trop tard pour pouvoir encore acquérir à des conditions avantageuses et lutter à armes égales avec la bourgeoisie.
C’est à celle-ci que les ventes ont surtout profité. Si, au commencement, elle paraît encore assez défiante, elle ne tarda pas à s’enhardir. L’appât était trop tentant pour qu’on y pût longtemps résister. Il fallait surtout éviter le scandale. On y réussissait en achetant par personne interposée, ou par « command ».
À partir du coup d’État de brumaire, la confiance plus grande dans la stabilité du régime augmente la hardiesse et le nombre des amateurs. Des industriels, comme L. Banwens à Gand et bien d’autres se font adjuger des bâtiments conventuels qu’ils transforment en ateliers.
Ce sont naturellement les partisans du nouveau régime qui ont ouvert la voie. Il suffit de parcourir les registres d’adjudication pour y relever les noms de ces « ralliés » : présidents et juges de tribunaux, juges de paix, maires, notaires, membres des Conseils généraux ou des Conseils d’arrondissement. Des conservateurs, des ci-devant, des nobles se laissent entraîner. La phrase de M. G. Lefebvre (Les paysans du Nord pendant la Révolution, p. 489) est aussi vraie pour la Belgique que pour la France : « Quand on peut suivre la destinée de quelques familles d’acquéreurs ou les transferts successifs d’un domaine, ce n’est pas toujours des amis de la Révolution que l’on rencontre chemin faisant ». Quant aux acheteurs campagnards, dont le nombre s’accroît, ce ne sont pas en règle générale des paysans, mais des membres de ce que l’on pourrait appeler la bourgeoisie rurale : brasseurs, meuniers, notables de village.
Autant que je puisse en juger, l’aliénation des domaines nationaux paraît donc avoir tourné en Belgique au profit de la classe possédante. Elle n’a guère augmenté la petite propriété ; elle a surtout dilaté la grande et rendu les riches plus riches qu’ils n’étaient. Des mains du clergé, le sol a passé surtout aux détenteurs du capital. Parmi ceux-ci, d’ailleurs, les « nouveaux riches » semblent en avoir recueilli beaucoup plus que les anciens propriétaires de la noblesse et de la bourgeoisie, de sorte que la grande opération dont on espérait l’égalisation des fortunes a servi surtout à affermir le crédit et à augmenter les ressources des capitalistes au moment même où, vers l’année 1800, le pays prend son essor industriel.
Elle a servi aussi, du point de vue politique, à consolider le régime nouveau introduit par la conquête française. Les acheteurs de biens nationaux, voyant en lui la garantie de leurs acquisitions, en ont été les plus fermes appuis. Il est même piquant de constater qu’après 1815, dans le Royaume des Pays-Bas, c’est parmi eux que la politique anti-cléricale du roi Guillaume recrutera ses partisans les plus convaincus.

Hoofdstuk I - Van den rechtstoestand van den Belgischen Congo.
Art. 1 - Het Belgische Congoland heeft eene persoonlijkheid, onderscheiden van die van het moederland.
Het wordt door afzonderlijke wetten beheerscht.
Het actief en het passief van België en het actief en het passief der Kolonie blijven gescheiden.
Bijgevolg blijft de dienst der Congoleesche rente uitsluitend ten laste van de Kolonie, tenzij eene wet er anders over beslist.
Bron: Officieel Jaarboek 1960
CHARTE COLONIALE DU 18 OCTOBRE 1908
LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE
(Modifiée et complétée par les lois des 29 mars 1911;5 mars 1912; 9 décembre 1912 ; l'Arrêté-loi du 14 novembre 1916; Lois des 10 août 1912; 12 août 1923;15 avril 1924; 3 août 1924;26 novembre 1926;18 mai 1929;22 juillet 1931; 27 juin 1935; L'Arrêté-loi du 19 mai 1942; loi du 13 juin 1951 et loi du 11 juillet 1951).
CHAPITRE 1er
DE LA SITUATION JURID
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ii
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes et avoirs et collections
sont l'objet d'une protection spéciale.
6. (Loi du 5 mars 1912). Il est institué une commission permanente chargée de veiller sur tout le territoire
de la colonie à la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles
d'existence.
Le Roi fixe le nombre des membres de la commission; il en arrête le règlement organique.
La commission est présidée par le procureur général près le tribunal d'appel de la capitale. Les
autres membres sont nommés par le Roi parmi les premiers résidants sur le territoire de la colonie qui par la
nature de leurs fonctions ou occupations, paraissent spécialement qualifiés pour accomplir cette mission
protectrice. La commission nomme son secrétaire dans son sein.
Elle se réunit au moins une fois chaque année; son président la convoque.
(Loi du 5 mars 1912). " Le Roi peut diviser la commission en sous-commissions, dont il arrête le règlement
organique.
Dans tous les cas, la commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en
faveur des indigènes. Ce rapport est publié.
Les membres de la commission dénoncent, même individuellement, aux officiers du ministère
public, les abus et les illégalités dont seraient victimes les indigènes.
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DES POUVOIRS
7. La loi intervient souverainement en toute matière. Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de
décrets, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi.
Toute loi a pour effet, dès sa publication, d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui
lui sont contraires.
Les cours et les tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois.
8. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés.
Les cours et les tribunaux n'appliquent les règlements et les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes
aux lois et aux décrets.
Aucun règlement ou arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié.
9. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui par cela s'en rend
responsable.
Sont également soumises à cette formalité les dépenses faites au moyen du fonds spécial de 50
millions de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l'article 4, alinéas 3 et 4, de
l'acte additionnel du 5 mars 1908.
Les annuités fixées par cet acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les propositions
énumérées dans l'alinéa 5 de l'article 4 du même acte.
10. (Loi du 12 août 1923). "Aucune taxe douanière, aucun impôt, ni aucune exemption d'impôt ne peuvent
être établis que par un acte législatif.
Les nouveaux décrets et ordonnances législatives qui les ont établis sont annexés en copie à
l'exposé des motifs du premier projet de budget colonial qui sera soumis aux Chambres législatives".
Le Gouverneur Général et les fonctionnaires ou agents de l'Administration coloniale dûment
autorisés par lui peuvent même en dehors des cas prévus par décret, accorder aux indigènes des exemptions
temporaires d'impôt.
Le produit des douanes et impôts est exclusivement réservés aux besoins de la colonie.
11. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours aux mêmes conditions dans la colonie.
Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d'argent frappées par l'Etat Indépendant du
Congo n'auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale.
Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera
attribué au budget colonial.
Il est loisible au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie; ces monnaies
n'ont pas cours en Belgique.
12. (Loi du 12 août 1923). " Le budget des recettes et des dépenses de la colonie est arrêté chaque année
par la loi. Toutefois, la loi budgétaire peut attribuer au budget une durée de deux ans".
Si les Chambres n'ont pas voté le budget cinq jours avant l'ouverture de l'exercice, le Roi arrête les
recettes, et de trois en trois mois jusqu'à la décision des Chambres, ouvre au Ministère des Colonies les
crédits provisoires nécessaires.
iii
Le Roi, ou, dans la colonie, le Gouverneur Général ordonne les virements et, en cas de besoins
urgents, les dépenses supplémentaires nécessaires.
Dans les trois mois, le Ministère des colonies transmet une expédition de l'arrêté royal ou de
l'ordonnance aux Chambres et dépose un projet de loi d'approbation.
13. Le compte général de la colonie est arrêté par la loi après la vérification de la Cour des Comptes.
La Cour examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les
dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi.
La Cour des Comptes se fait délivrer par le ministère des colonies tous états, pièces comptables, et
donner tous renseignements et éclaircissements nécessaires au contrôle de la recette et de la dépense des
deniers.
Le compte général de la colonie est communiqué aux Chambres avec les observations de la Cour
des comptes.
14. La colonie ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter les travaux sur
ressources extraordinaires que si une loi l’y autorise.
(Loi du 22 juillet 1931). « Toutefois, si le service du Trésor colonial l'exige, le Roi peut, sans autorisation
préalable, créer ou renouveler des bons du trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera
pas cinq ans.
Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 70 millions de francs et leur produit ne
pourra être affecté qu'au paiement de dépenses régulièrement votées".
15. (Arrêté-loi du 19 mai 1942). " Les cessions et concessions sont réglées par les règles suivantes :
1. Toute concession de chemin de fer ou de mines est consentie par décret.
Toutefois, aux conditions générales établies par décret le Gouverneur Général peut accorder des concessions
de mines de 800 hectares au plus.
2. Les cessions et, pour quelque durée que ce soit, les concessions de biens domaniaux, sont
consenties ou autorisées par décret
a) si les biens situés hors du périmètre des circonscriptions déclarées urbaines par le Gouverneur Général
ont une superficie de plus de 500 hectares et sont cédées ou concédées à titre onéreux aux conditions
générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres;
b) si les biens, dans tous les autres cas, ont une superficie de plus de 10 hectares.
3. Toutefois, aux conditions générales établies par décret, le Gouverneur Général peut céder ou
concéder gratuitement des terres situées hors du périmètre desdites circonscriptions et à concurrence de 700
hectares, si elles sont destinées à la culture, l'élevage ou l'exploitation forestière, ou à concurrence de 5
hectares si elles n'ont pas cette destination.
4. Aux conditions générales établies par décret et sous réserve dans chaque cas, d'une approbation par
le Roi, le Gouverneur Général peut céder ou concéder gratuitement aux associations scientifiques,
philanthropiques ou religieuses et aux établissements d'utilité publique reconnus conformément à la
législation, des terres situées dans le périmètre desdites circonscriptions, à concurrence de 10 hectares et des
terres, situées hors de ce périmètre à concurrence de 200 hectares.
5. Sont déposés, avec toutes les pièces justificatives, pendant trente jours de session, sur les bureaux
des deux Chambres, tous projets de décret portant ;
a) concession de chemin de fer, mines ou alluvions aurifères;
b) cession d'immeubles domaniaux d'une superficie excédant 10.000 hectares;
c) concession de la jouissance d'immeubles domaniaux, si leur superficie excède 25.000 hectares et si
la concession pour plus de trente ans.
6. Pour déterminer le maximum de superficie prévu aux paragraphes qui précèdent, il est tenu compte
des cessions ou concessions de biens domaniaux dont le cessionnaire ou le concessionnaire a bénéficié
antérieurement dans la même province. La totalisation n’a pas lieu, si la nouvelle cession ou concession a
pour objet des biens dont la superficie n’excède pas deux hectares et si elle est faite à titre onéreux, aux
conditions générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a
pas les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a pas lieu, non plus, si les terres hors du
périmètre des circonscriptions urbaines, qui font l'objet de cessions ou de concessions prévues au par 4, sont
situées à 10 kilomètres au moins des terres de même nature antérieurement cédées ou concédées.
7. Tout acte accordant une concession la limitera à un temps déterminé, renfermera une clause de
rachat et mentionnera les cas de déchéance.
8. Un relevé des cessions et concessions gratuites accordées en application des
par. 3 et 4, ainsi que les concessions de mines, accordées par application du 2ème alinéa du par. 1 est inséré
dans le rapport sur l'Administration du Congo belge présenté aux Chambres".
ANNEXES
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO iv
16. Le contingent de la force publique est fixé annuellement par décret.
17. (Loi du 10 août 1921) " La justice civile et la justice militaire sont organisées par décret. Les officiers
du ministère public exercent leurs fonctions sous l'autorité du ministre des colonies, qui peut donner
délégation au Gouverneur Général. "
18. (Loi du 11 juillet 1951)
* 1. A l'exception des cas prévus par décret, les magistrats de carrière ne peuvent être nommés à titre
définitif qu'après avoir été désignés provisoirement pour une période de services effectifs dont la durée ne
peut excéder trois ans.
* 2. Les magistrats de carrière sont nommés définitivement par le Roi, pour un seul terme de vingt-trois ans
de services effectifs.
Ce terme est, à leur demande, porté à vingt-sept ans de services effectifs ou jusqu'à l'expiration de leur
60ème année. Toutefois, en aucun cas, la carrière des magistrats ne pourra se prolonger au-delà de leur
65ème année d'âge. Le terme pour lequel les magistrats de carrière sont nommés définitivement comprend
le temps de services effectifs accomplis par eux en qualité de magistrat à titre provisoire ou dans tout autre
service que la magistrature.
* 3. A la demande des intéressés ou d'office, il peut être mis fin à la carrière des magistrats nommés à titre
définitif, dans la seizième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième ou la vingt-cinquième année de services
effectifs. Il ne peut être mis fin à la carrière des présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours
d'appel, ni à celle des présidents et juges des tribunaux de première instance, selon les précisions ci-dessus,
que sur la proposition du Gouverneur Général, pour les causes déterminées par décret, et de l'avis conforme
de la cour d'appel.
* 4. Les magistrats de carrière qui obtiennent leur retraite après quinze ans au moins de services effectifs
sont admis à la pension. Les traitements, congés et pensions sont fixés par décret.
La loi du 11 juillet 1951 contient les dispositions "transitoires suivantes :
1. Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore accompli un
terme complet de vingt-trois ans de services effectifs, peuvent l'achever, quel que soit leur âge.
2. La carrière des magistrats qui ont été renommés ou confirmés pour une second terme de vingt-trois ans,
prend fin à l'expiration de la période triennale de services effectifs en cours à la date de l'entrée en vigueur
de la présente loi, et au plus tard un an après cette dernière date.
18bis (Loi du 27 juin 1935). " Les présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours
d'appel ainsi que les présidents et juges des tribunaux de première instance, définitivement nommés, ne
peuvent plus être déplacés sans leur consentement que pour des besoins urgents et par mesure provisoire.
Toutefois, les juges des tribunaux de première instance peuvent être déplacés sans leur consentement dans le
ressort du tribunal de première instance auquel ils sont attachés; ils peuvent être déplacés hors du ressort des
modifications qui sont apportées aux circonscriptions judiciaires dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
Dans tous les cas de déplacement, les présidents, conseillers et conseillers suppléants des cours d'appel ainsi
que les présidents et juges des tribunaux de première instance, définitivement nommés, reçoivent un
traitement au moins équivalent à celui qui était attaché à leurs anciennes fonctions.
Le Roi a le droit de suspendre et de révoquer les magistrats du parquet. Il ne peut suspendre ni révoquer les
autres magistrats de carrière définitivement nommés que sur la proposition du Gouverneur Général, pour les
causes prévues par décret et de l'avis conforme de la cour d'appel".
19. L'autorité administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.
Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de sûreté publique, suspendre, dans un territoire et pour un
temps déterminé, l'action répressive des cours et tribunaux civils et y substituer celle des juridictions
militaires.
(Arrêté-Loi du 14 novembre 1916). « En cas d'urgence, le Gouverneur Général, et dans les
territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement général, le vice-gouverneur général ont le même
pouvoir. Ils ne peuvent l'exercer qu'après avoir pris l'avis du procureur général ou de l'Officier du ministère
public délégué par le procureur général ».
20. La justice est rendue et ses décisions sont exécutées au nom du Roi.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les
mœurs, et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Le Roi a le droit de remettre, de réduire et
de commuer les peines,
21. Le Roi est représenté dans la colonie par un Gouverneur général, assisté d'un ou de plusieurs vicegouverneurs généraux.
v
ANNEXES
Sauf les personnes qui ont administré en l'une ou l'autre de ces qualités le territoire de l'Etat Indépendant du
Congo, nul ne peut être nommé aux fonctions de Gouverneur Général ou de vice-gouverneur général s'il
n'est Belge de naissance ou par grande naturalisation.
22. (Loi du 29 mars 1911). « Le pouvoir exécutif ne peut déléguer l'exercice de ses droits qu'aux personnes
et aux corps constitués qui lui sont hiérarchiquement subordonnés.
Le Gouverneur Général et, dans les territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement général, le vicegouverneur général exercent par voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le Roi leur délègue.
Le Gouverneur Général et, dans les territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement, le vicegouverneur général peuvent, s'il y a urgence, suspendre temporairement l'exécution des décrets et rendre des
ordonnances ayant force de loi. Les ordonnances ayant cet objet cessent d'être obligatoires après un délai de
six mois si elles ne sont, avant l'expiration de ce terme, approuvées par décret.
Les ordonnances ayant force de loi et les ordonnances d’administration générale ne sont
obligatoires qu’après avoir été publiées dans les formes prescrites par décret ».
CHAPITRE IV
DU MINISTRE DES COLONIES ET DU CONSEIL COLONIAL
23. Le Ministre des colonies est nommé et révoqué par le Roi. Il fait partie du conseil des ministres. Les
articles 86 à 91 de la Constitution belge lui sont applicables.
24. Il est institué un conseil colonial composé d'un président et de quatorze conseillers.
(Loi du 39 mais 1911). « Le Ministre des colonies préside le conseil.
Il y a voix délibérative, et s'il y a partage, prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par un vice-président choisi par le Roi au sein du conseil.
Huit conseillers sont nommés par le Roi. Six sont choisis parmi les chambres législatives : trois par le sénat
et trois par la chambre des représentants; ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des voix ».
(Loi du 9 décembre 1912). " Un des conseillers nommés par le Roi et alternativement un des
conseillers nommés par la chambre ou un des conseillers nommés par le sénat sortent chaque année. Les
conseillers sortent d'après leur rang d'ancienneté; ils peuvent être renommés.
En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, par démission, décès ou autrement, le
nouveau conseiller achève le mandat de celui qu'il remplace ».
Les fonctions de conseiller et de membre de la chambre des représentants ou du sénat sont incompatibles.
Les fonctionnaires de l'administration coloniale en activité de service ne peuvent faire partie du
conseil.
25. Le conseil colonial délibère sur toutes les questions que lui soumet le Roi.
Sauf le cas d'urgence, le conseil colonial est consulté sur tous les projets de décret. Les projets lui sont
soumis par le Roi; ils sont accompagnés d'un exposé de motifs.
Le conseil donne son avis, sous forme de rapport motivé, dans le délai fixé par son règlement
organique. Le rapport indique le nombre des opposants ainsi que les motifs de leur opposition.
Si le projet de décret soumis à la signature du Roi n'est pas conforme à l'avis du conseil, le
ministre des colonies y joint un rapport motivé.
Si le conseil ne s'est pas prononcé dans le délai fixé par son règlement, le décret peut être rendu sur un
rapport motivé du ministre des colonies.
Le projet du conseil colonial et, éventuellement, le rapport du ministre des colonies sont publiés
en même temps que le décret.
Les décrets rendus en cas d'urgence sont soumis au conseil dans les dix jours de leur date ; les
causes de l’urgence lui sont indiquées.
Le rapport du conseil est publié au plus tard un mois après la communication du décret.
26. Le conseil colonial demande au gouvernement tous les renseignements qu'il juge utiles à ses travaux. Il
peut lui adresser des vœux.
CHAPITRE V
DES RELATIONS EXTERIEURES
27. Le Roi fait les traités concernant la colonie.
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO vi
Les dispositions de l'article 68 de la Constitution belge relatives aux traités s'appliquent aux traités
qui concernent la colonie.
28. Le ministre des affaires étrangères du royaume a dans ses attributions les relations de la Belgique avec
les puissances étrangères au sujet de la colonie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
29. Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux siégeant dans la métropole et
les sentences arbitraires exécutoires en Belgique ont dans la colonie l'autorité de la chose jugée et y sont
exécutoires de plein droit.
Les actes authentiques exécutoires en Belgique sont exécutoires de plein droit dans la colonie.
(Loi du 15 avril 1924). « Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux
siégeant dans la colonie et les sentences arbitraires exécutoires au Congo et en Belgique ont l'autorité de la
chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.
Les actes authentiques exécutoires dans la colonie sont exécutoires de plein droit en Belgique ».
30. Quiconque, poursuivi pour une infraction commise dans la colonie, sera trouvé en Belgique, y sera
jugé par les tribunaux belges conformément à la loi pénale coloniale, mais dans les formes prévues par la loi
belge.
Les peines de servitude pénale prévues par la loi pénale coloniale sont, suivant leur durée,
remplacées par des peines d'emprisonnement, de réclusion ou de travaux forcés de même durée.
(Loi du 26 novembre 1926). La chambre des mises en accusation pourra renvoyer l'inculpé devant
la juridiction coloniale, soit à sa demande, soit en vertu d'une décision unanime rendue sur la réquisition du
ministère public, l'inculpé entendu ou dûment cité. L'audience sera publique à moins que l'inculpé ne
réclame le huis clos. Le cas échéant, la chambre prolongera, pour autant que de besoin, la durée de la
validité du mandat".
Quiconque, poursuivi pour une infraction commise en Belgique, sera trouvé sur le territoire de la
colonie, sera livré à la justice belge pour être jugé conformément aux lois belges.
L'inculpé, si l'autorité belge n'en a pas réclamé la remise, pourra se faire représenter devant la
juridiction belge par un fondé de pouvoir spécial.
Quand une infraction consiste en faits accomplis en partie sur le territoire belge et en partie sur le
territoire colonial, elle sera considérée comme ayant été commise en Belgique.
S'il y a plusieurs coauteurs dont les uns sont trouvés sur le territoire belge et les autres sur le
territoire colonial, les tribunaux belges sont seuls compétents.
Le tribunal compétent à l'égard des auteurs principaux est également compétent à l'égard des
complices.
30 bis. Les décisions rendues en matière pénal par la justice belge ou la justice coloniale ont sur le territoire
belge et sur le territoire colonial l’autorité de la chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.
(Loi du 26 novembre 1926). " Les individus condamnés par la justice belge ou la justice coloniale
à des peines privatives de la liberté les subiront dans les prisons belges ou dans les prisons coloniales,
suivant qu'ils auront été trouvés en Belgique ou dans la colonie.
Lorsque l'exécution est poursuivie en Belgique, la servitude pénale prononcée par les tribunaux de
la colonie est remplacée, si elle ne dépasse pas cinq ans, par un emprisonnement de même durée; si elle est
de plus de cinq ans mais ne dépasse pas dix années, par une réclusion de même durée; si elle dépasse dix
années, par les travaux forcés de même durée.
vii ANNEXES
Lorsque l'exécution est poursuivie dans la colonie, les peines privatives de la liberté prononcées
par les tribunaux belges sont remplacées par une servitude pénale de même durée".
30 ter. (Loi du 26 novembre 1926). " Les condamnés, autres que les indigènes de la colonie ou des colonies
voisines, qui subissent dans les prisons coloniales des peines principales de servitude pénale dont le total
dépasse six mois peuvent être transférés dans les prisons belges.
Le transfert sera ordonné par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vicegouverneur général de la province dans laquelle le condamné est détenu, après avis du procureur général
près la cour d'appel du ressort ou du procureur du Roi à ce délégué par ce dernier.
Un arrêté royal détermine le prix de la journée d'entretien dans les prisons belges et dans celles de
la colonie.
La colonie supporte les frais de détention et les frais de transfert des individus condamnés du chef
d'infractions commises dans la colonie
La métropole supporte les frais de détention et les frais de transfert des individus condamnés du
chef d'infractions commises hors de la colonie
30 quater (Loi du 26 novembre 1926). " Le produit des amendes prononcées par les tribunaux de la colonie
et par les tribunaux belges du chef d'infractions commises dans la colonie est versé au Trésor colonial.
Le produit des amendes perçues dans la colonie, mais prononcées par les tribunaux belges du chef
d'infractions commises hors de la colonie, est versé au Trésor métropolitain".
30 quinquets.- (Loi du 26 novembre 1926). " En ce qui concerne la libération conditionnelle, les condamnés
sont soumis aux dispositions de la loi belge ou à celles de la loi coloniale, selon qu'ils subissent leurs peines
ou se trouvent en état de liberté conditionnelle en Belgique ou dans la colonie.
Toutefois, les dispositions de la loi coloniale sont applicables, quant à la quotité des peines et à la
durée de l'incarcération à subir, aux condamnés qui subissent en Belgique des peines prononcées du chef
d'infractions commises dans la colonie.
La mise en liberté des individus condamnés par les tribunaux de la colonie et qui subissent leur
peine en Belgique est ordonné par le ministre de la justice après avis du directeur et de la commission
administrative de l'établissement pénitentiaire ainsi que du procureur général prés la cour dans le ressort de
laquelle est situé cet établissement.
La mise en liberté des individus condamnés par les tribunaux belges et subissant leur peine dans la
colonie est ordonnée par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vice-gouverneur de la
province dans laquelle le condamné est détenu, après avis du directeur de la prison et du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ou du procureur du Roi à ce délégué par ce
dernier.
La mise en liberté est révoquée par le Gouverneur Général ou, en cas de délégation, par le vicegouverneur général de la province dans laquelle le libéré se trouve, après avis du procureur général de la
province dans laquelle le libéré se trouve, après avis du procureur général du ressort, ou du procureur du Roi
à ce délégué par ce dernier.
31. En toutes matières, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes
domiciliées ou résidant dans la colonie est soumise en Belgique aux règles générales relatives à la
signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger. Toutefois, le ministre des
colonies intervient, le cas échéant, en lieu et place du ministre des affaires étrangères.
Réciproquement, la signification des actes judiciaires destinés à des personnes domiciliées ou
résidant en Belgique est soumise dans la colonie aux règles générales relatives à la signification des actes
destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger.
Les commissions rogatoires émanant de l’autorité compétente belge ou coloniale sont exécutoires
de plein droit sur le territoire beige et sur le territoire colonial.
LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO viii
32. Les membres des chambres législatives ne peuvent être en même temps fonctionnaires salariés,
employés salariés ou avocats en titre de l'administration coloniale.
A dater de la promulgation de la présente loi, aucun membre d'une des deux chambres législatives
ne peut être nommé ou, s'il occupe actuellement pareilles fonctions, à l'expiration de leur terme, ne peut être
renommé délégué du gouvernement, administrateur ou commissaire dans des sociétés par actions qui
poursuivent dans le Congo belge des entreprises à but lucratif, si ces fonctions sont rétribuées à un titre
quelconque et si l'Etat est actionnaire de la société.
Cette dernière interdiction s'applique également aux membres du conseil colonial, au gouverneur
général, aux vice-gouverneurs généraux, aux magistrats et aux fonctionnaires au service de l'administration
coloniale
Les candidats aux chambres, élus bien qu'ils exercent des fonctions sujettes aux interdictions qui
précèdent, ne sont admis à la prestation du serment qu'après les avoir résignées.
Les membres des chambres ne peuvent être nommés aux fonctions et emplois prévus aux alinéas 1
et 2 qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. N'est pas soumise à ce délai, la nomination
aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général de la colonie.
33. (Loi du 18 mai 1929).
* 1. Les fonctionnaires et militaires belges autorisés à accepter des fonctions publiques dans la colonie avant
ou après l'annexion de celle-ci, conservent leur ancienneté et leurs droits à l'avancement dans
l'administration ou l'armée qu'ils ont temporairement quittée.
Les augmentations de traitement et les promotions de grade leur sont conférées au moment où ils
les auraient obtenues s'ils étaient restés effectivement au service de la métropole.
Sont assimilés à des fonctions publiques pour l'application du présent paragraphe, les emplois
dans les organismes exploitant des services reconnus d'utilité publique par une loi.
2. Les magistrats belges autorisés à accepter un poste dans la magistrature de la colonie, conservent leur
ancienneté et leurs droits à l'avancement dans la magistrature de la métropole".
34. Les Belges mineurs ne peuvent s’engager dans l’armée coloniale sans le consentement écrit de leur
père ou de leur mère veuve, ou s’ils sont orphelins, de leur tuteur. Ce dernier devra être autorisé par
délibération du conseil de famille.
Pendant la durée de leur service actif, les miliciens belges ne peuvent être autorisés à prendre du
service dans l'armée coloniale. Toute autorisation qui leur serait donnée en violation de la présente
disposition de la loi sera considérée comme nulle et non avenue.
35. Indépendamment du drapeau et du sceau de la Belgique, la colonie du Congo peut faire usage du
drapeau et du sceau dont s'est servi l'Etat du Congo.
36. Les décrets, règlements et autres actes en vigueur dans la colonie conservent leur force obligatoire, sauf
les dispositions qui sont contraires à la présente loi et qui sont abrogées.
37. (Loi du 12 août 1923). « Chaque année, avant la fin du mois d'octobre, il est présenté aux Chambres,
au nom du Roi, un rapport sur l'administration du Congo belge ».
Ce rapport contient tous les renseignements propres à éclairer la représentation nationale sur la
situation politique, économique, financière et morale de la colonie.
Il rend compte de l'emploi pendant l'exercice écoulé de l'annuité prévue par l'article 4 de l'Acte
additionnel au traité de cession de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique.
DISPOSITION TRANSITOIRE
38. Après l'annexion, les magistrats de carrière, les fonctionnaires et tous autres agents de l'Etat
Indépendant du Congo conserveront leurs attributions jusqu'au terme et dans les conditions prévues par leur
contrat d'engagement.

Un décret en d ate du 5 novem bre 1906, au torise le S ecrétaire d ’È tat à con clure, avec 1’ « A m erican C ongo C om p any », u ne con ven tion accordant à cette d ern ière, pour soixan te ans, le d roit de récolter le caou tch ou c et au tres p rod u its v ég é ta u x dans les terres su ivan tes :
U n p rem ier lo t au N ord du Kasai con stitu é par u ne bande de a 5 k ilom ètres de largeu r le lo n g de la rive ga u ch e du C ongo ju sq u ’à la rivière Y um bi, un second lot au S ud du Kasai co n tig u au p rem ier et com p ris en tre les lim ites su ivan tes : l’em b ou ch u re du Kasai ju sq u ’au p oin t de confluence avec la rivière M oba; la rive gau ch e du lit visib le de la Moba ju sq u ’à son p o in t ex trêm e; de ce p oin t la lig n e de faîte en tre le C ongo et le K w an go jusq u ’au p o in t le p lu s rap p roch é de B an kan a; de là, u n e d roite p assant par B ankana et a llan t ab ou tir au con flu en t de la S ele (S ta n ley -P o o l) et en su ite la rive gau ch e du C ongo ju sq u ’au con flu en t du Kasai, ces d eu x lo ts com p renan t une superficie totale d ’en viron 1,000,000 d’h ecta res sans garan tie de surface.
L es terres in d ig èn es, les p rop riétés privées, les terres faisant p artie du d om ain e p ub lic de l’É tat qui s’y trou ve¬ raien t enclavées n e font pas partie de la con cession . L ’ « A m erican C ongo C om p any » devra resp ecter les servi¬ tu d es tant p u b liq u es q ue p rivées a ctu e llem en t existan tes et celles q u i p ou rraien t être d écrétées par des lo is de l ’É tat. C elui-ci con serve n otam m en t le d roit, ta n t p our lu i- m ê m e q ue p our les p articu liers q u ’il au toriserait à cette fin, de faire d an s les forêts voisin es des cours d’eau, des cou p es de bois d estin é à a lim en ter les ch au d ières des vap eu rs et à ravitailler les postes. D es d ép ôts d e bois p ou rron t être étab lis à cet effet.
O utre cette con cession , l’É tat, après en ten te avec la F ond ation de la C ouronne, s ’e n gage à m ettre à la d isp o¬ sition de 1’ « A m erican C ongo C om p an y » d eu x blocs d ’en viron 5 ,ooo h ectares ch acu n , à ch oisir d’accord avec le C om m issaire de d istrict et le d é lég u é de la F on d ation de la C ouronne, à p ro x im ité d ’u ne voie navigable. Ces terres seron t à la d isp osition d e la S ociété p en d an t u n e d u rée de d eu x ans, ren ou velab le p our u n e d urée égale, p our y faire su r les arbres, lian es à caou tch ou c , h erb es et au tres v é g é ¬ tau x , des exp ériences de récolte par des procédés m éca¬ n iq u es ou ch im iq u es. L ’ « A m erican C ongo C om pany » aura su r ces terrains, p en dan t la durée c i-d essu s, tou s les droits de d isp osition du propriétaire et elle n e sera n otam ¬ m en t p as ten u e de se conform er au x d isp osition s du décret d u 22 sep tem b re 1904, su r la récolte du caou tch ou c des terres et forêts d om an iales, m ais elle aura l ’o b ligation , lors de la restitu tion des terrains, de rem placer les plantes d étru ites et d e rem ettre les terrain s d ans les con d itions p rim itives, p ou r au tan t q u e cela so it p ossib le, eu égard à la n atu re des exp érien ces faites.
O utre les avan tages in d iq u és ci-d essus, l’É tat, selon
en g a g em en t an térieu r , a accordé à la C om pagnie u n e op tion p en dan t d ix ans p our l ’achat de terres d on t la superficie totale ne pourra dép asser 5 oo,ooo hectares.

Enregistrement des terres.
L e Gouverneur G énéral,
V u le décret du Roi-Souverain du 14 septembre
1886;
Revu l’arrêté du 8 novembre 1886,
Arrête :
A rticle premier.
L ’alinéa Ier de l’article 4 de l’arrêté du 8 novembre 1886 est abrogé et remplacé par la disposition
suivante :
« Lorsque la propriété d’un immeuble déjà enre-
» gistré sera transférée par vente ou par échange, le
» contrat de vente ou d’échange devra être fait et signé
» devant le Conservateur des Titres Fonciers.
» Toutefois, en cas d’absence ou d’éloignement des
» parties, et à défaut de mandataires institués en vertu
» d’une procuration spéciale et authentique, le Con-
» servateur des Titres Fonciers enregistrera les actes de
» vente ou d’échange passés dans la forme authentique
» soit au Congo, soit à l’étranger. »
A rticle 2 .
L ’article 6 du même arrêté est abrogé et remplacé
par la disposition suivante :
« Lorsqu’une propriété immobilière sera donnée à
— 52 —
» bail pour une durée de plus de cinq ans, le contrat
» de location sera soumis aux formes prévues par
» l’article 4 pour les contrats de vente ou d’échange. »
A rticle 3 .
Le Conservateur des Titres fonciers est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui entrera eu vigueur à
la date de ce jour.
Borna, le z3 février 1906.
Baron W ahis.

12 000 grandes propriétés de plus de 50 feddans5 (21 ha), soit 1,3 pour cent du total des propriétés, qui détenaient 942 000 ha, soit 44 pour cent du total des terres cultivables;
141 000 moyennes propriétés de 5 à 50 feddans (2,1 à 21 ha), soit 15,4 pour cent du total des propriétés, qui détenaient 738 000 ha, soit 34 pour cent du total des terres;
761 000 petites propriétés de moins de 5 feddans (moins de 2,1 ha), soit 83,3 pour cent du total des propriétés, qui détenaient 467 000 ha, soit 22 pour cent du total des terres.
Mais ces catégories de propriété recoupent mal, en fait, les catégories d'exploitations, car une partie des moyennes et des grandes propriétés étaient, déjà à cette époque, louées à des métayers ou à des fermiers.
Dans ces conditions, à la fin du XIXe siècle, on trouvait en Égypte des grands propriétaires exploitant leurs terres en faire-valoir direct avec des salariés (régisseurs, chefs de culture, salariés permanents et journaliers), et une multitude de très petits exploitants, très pauvres car disposant de trop peu de terres pour employer pleinement leur main-d'oeuvre familiale et subvenir à leurs besoins. Parmi eux, il y avait des fermiers et aussi des métayers au cinquième à propos desquels J. Barois a écrit: «Le propriétaire prend à sa charge l'impôt, les frais d'irrigation, les semences, le bétail et le matériel agricole (c'est-à-dire le capital fixe et le capital circulant de l'exploitation, travail non compris). Pour son travail, le fellah reçoit le cinquième de la récolte d'été (coton et légumes), le quart de la récolte de maïs (d'automne); il n'a droit à rien sur les récoltes d'hiver; un demi-hectare de terre est aussi alloué à chaque père de famille pour cultiver du trèfle6». Il y avait également beaucoup d'ouvriers agricoles, le plus souvent durement exploités et extrêmement misérables.
Mais on trouvait aussi des paysans «patrons» employant tout à la fois de la main-d'œuvre familiale et des salariés, ainsi que des paysans moyens employant pleinement leur main-d'œuvre familiale et possédant la totalité ou la plus grande partie de leurs terres. C'est pourquoi la question agraire en Égypte à la fin du XIXe siècle ne saurait être réduite à une opposition entre quelques grands propriétaires capables d'investir et une multitude d'exploitants minifundistes condamnés à vendre leur force de travail et à rester très pauvres, à l'instar de la situation lati-minifundiste qui prévalait en Amérique latine et dans les régions périphériques du sud et de l'est de l'Europe industrialisée.
Il n'en reste pas moins que les inégalités d'accès à la terre et à l'eau ont conduit à des conflits ouverts dans les campagnes à la fin du XIXe siècle. Ces conflits ont même pris un tour violent au début du XXe siècle, quand l'éviction des petits exploitants incapables de rembourser leurs dettes a pris une ampleur sans précédent du fait des bas prix agricoles et des dégâts causés par le ver du coton, et les conflits ont alors souvent dégénéré en batailles rangées entre paysans d'un côté, forces de l'ordre, police et armée anglaise de l'autre7.
Conscient des risques sociaux qu'impliquait le processus d'endettement et d'exclusion de la petite paysannerie, conscient aussi que l'élimination des petites propriétés au profit des grandes n'allait pas dans le sens de la maximisation de la production de coton, le gouvernement, dominé par les Britanniques, adopta en 1905 une loi interdisant l'expropriation pour dettes des paysans possédant moins de 2,1 ha (loi Kitchener, dite loi des cinq feddans)8.
Malgré cette loi, le processus de minifundisation et d'exclusion a continué dans la première moitié du XXe siècle, et il a même pris des proportions considérables. Ainsi, le nombre de familles paysannes sans terre, qui était déjà de 697 000 en 1929 soit 37 pour cent des familles rurales, est passé à 1 107 000 soit 53 pour cent en 1939, et à 1 469 000 soit 60 pour cent des familles rurales en 19509. Ainsi, encore au début de 1952, la répartition de la propriété des terres cultivables était particulièrement inégale: 0,4 pour cent des propriétaires fonciers possédaient 34 pour cent des terres sous forme de domaines de plus de 50 feddans, et 2 000 de ces propriétaires, soit 0,1 pour cent de l'ensemble des propriétaires fonciers, détenaient 20 pour cent des terres, avec des domaines de plus de 200 feddans; à l'autre extrême, 72 pour cent des propriétaires fonciers possédaient des lopins de moins de 1 feddan, qui ne représentaient que 13 pour cent de la terre cultivable10. Qui plus est, le montant du loyer de la terre s'établissait en moyenne à 75 pour cent de la valeur ajoutée nette, un taux exorbitant à l'avantage des propriétaires11 et les contrats de location étaient précaires car verbaux et de courte durée (de quelques mois à un an).
En conséquence, les conflits et les actes de violence se multiplièrent dans les campagnes au cours des années qui précédèrent la prise de pouvoir par les Officiers libres conduits par Nasser en 195212.
http://www.fao.org/DOCREP/003/X8050T/x8050t08.htm (20040905)

Ce compromis sanctionné par le décret royal du 30 octobre 1892 organise un régime transactionnel et transitoire. Les « terres vacantes » du territoire sont divisées en trois zones : une première zone, que l’État se réserve, qui deviendra son « Domaine privé » et qu’il fera exploitfactoer, en régie, par ses agents ; une deuxième dont il autorise l’accès aux particuliers ; une troisième qui est provisoirement réservée pour cause de sécurité publique 1 .
Le bassin du Kasaï et donc le pays de Ding orientaux entre dans la deuxième catégorie.
À la suite de ce modus vivendi dit de Wahis et du décret du 30 octobre 1892, une partie du bassin conventionnel du Congo était ouverte à la liberté du commerce 2 . Il s'était crée ainsi à l’intérieur du pays une sorte de no man’s land commercial et économique. Parmi les régions visées par le décret figuraient les rives du Congo et le bassin du Kasaï (donc le territoire des Ding orientaux) qui devient, selon l’expression de Wauters, « un os à ronger abandonné par le Roi aux compagnies privées » 3 . Dans le bassin du Kasaï, la partie concernée par le décret royale était limitée au Nord par la ligne de faîte qui sépare le bassin du Lac Léopold II de celui du Kasaï et du Sankuru, à l’Est par les territoires du Comité spécial du Katanga, au sud par les frontières de l’État, à l’ouest par l’Inzia. À partir de 1893 cette région sera littéralement investie par des sociétés commerciales européennes à la recherche de l’ivoire et du caoutchouc.
Entre 1893 et 1900 quatorze sociétés, à la recherche de l’ivoire, du caoutchouc et accessoirement du copal, investissent cette région.
L’État, malgré son retrait apparent y était aussi présent pour la « récolte » de ces mêmes produits.
Par un ensemble des décrets publiés entre 1885 et 1887, Léopold II, s’inspirant des techniques de colonisation pratiquées par les Européens en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie, s’approprie toutes les terres du Congo et les répartit en trois catégories : les terres indigènes, les terres vacantes et les terres concédées à des tiers, personnes physiques ou morales. Les terres indigènes sont, d’après les règlements de l’État léopoldien, celles qui sont occupées et exploitées par les populations indigènes sous l’autorité de leurs chefs et régies par les coutumes et les usages locaux. Pour l’État léopoldien occupation et exploitation signifie la pratique de l’agriculture. Pour les autochtones, toutes les surfaces destinées à l’agriculture, à la chasse, à la cueillette, à la pêche, etc., sont considérées comme rentabilisées et appartiennent à un clan ou à une famille. Les terres vacantes étaient, pour Léopold II, celles sur lesquelles les indigènes ne pratiquaient pas l’agriculture. Ces terres étaient supposées être sans maître et abandonnées au bon vouloir du roi. Dans l’entendement des autochtones et suivant leurs lois, il n’existe aucune terre qui soit vacante. Suivant sa logique, Léopold II répartit ses « terres vacantes » en terres non mises en valeur et en domaines nationaux, exploités en régie pour permettre à l’État de financer ses dépenses. Le roi s’est aussi autorisé à concéder aux tiers des terres supposées vides. C’est ainsi que les compagnies commerciales et les missions se sont vues octroyer des propriétés foncières souvent contre la volonté des autochtones. Lire HEYSE, Th, Grandes lignes du régime de terres du Congo belge et du Rwanda-Urundi, Bruxelles, ARSOM, 1947 ; POURTIER, A., « La dialectique du vide. Densité de population et pratiques foncières en Afrique centrale forestière » in Politique africaine, n° 21, p. 10-21 ; NDAYWEL, Histoire générale…, p. 322-325.


Op die eenvoudige manier werd Leopold II eigenaar van quasi alle gronden in Congo.

L'abbaye de Notre-dame de l'Olive, située dans le quartier qui porte aujourd'hui son nom, existait depuis le XIIIème siècle. Elle était réservée aux femmes et appartenait à l'ordre des Cisterciens, qui devait cette dénomination à l'abbaye de Citeaux en Bourgogne (arrondissement de Baume), et qui observait, au départ, une rèle très stricte : "que la nourriture soit non carnée et préparée sans graisse, sauf pour ceux qui sont tout à fait malade et pour les ouvriers gagés... Les moines de notre Ordre doivent tirer leur subsistance du travail de leurs mains, de la culture des terres et de l'élevage des troupeaux...".
Au cours des siècles, l'abbaye connut bien des drames, sur lesquels nous reviendrons un jour. Coincée entre les monastères de Lobbes, d'Aulne et de Bonne-Espérance (près de Binche), elle resta un établissement relativement pauvre, au point qu'au XVIIIème siècle l'impératrice Marie-Thérèse fixa le maximum de la communauté à 16 dames et 4 converses.
En 1794, lors de la seconde conquête des Pays-Bas autrichiens (nos provinces), les troupes révolutionnaires françaises incendièrent le couvent, de même que le troisième château de Mariemont construit en 1756 par Charles de Lorraine.
Ce que le feu avait épargné fut saccagé par les pillards. On vit, par exemple, la commune de Morlanwelz racheter en 1804 la cloche de l'église à un certain Joachim Dusart.
Les religieuses essayèrent de réintégrer leur monastère en 1795. Mais, le 1er octobre de cette année, la convention vota l'annexion de la Belgique à la France et appliqua les décrets de la constituante qui, en 1790, avait nationalisé les biens ecclésiastiques.
Le 26 juillet 1798, "en la salle de vente de l'administration centrale du département de Jemmapes, en la commune de Mons", on mit en vente la "ci-devant" abbaye de l'Olive et quelques dépendances situées sur les communes de Morlanwelz, Bellecourt et La Hestre. Les affiches et les procès-verbaux d'estimation, conservés aux archives de l'état à Mons, donnent la description des biens et le résultat de la vente.
Il fallut 3 séances, dont la dernière inutile parce que sans surenchères pour vendre ces biens, acquis pour 300.000 francs, moitié par Isidore Warocqué, de Mons, le frère de Nicolas, et moitié par G-F. Deschuytener, d'Haine-Saint-Pierre.
En 1835, on est frappé par le morcellement de ces biens. Les parcelles sont numérotées de 215 à 254 et elles appartiennent alors à sept propriétaires différents : la Société de Mariemont détient 4 parcelles dont une houillère, le terrain environnant et un chemin privé qui conduit à Bellecourt; Madame Lemaire de Morlanwelz 2 parcelles; Daminet, d'Henghien, une maison de 60 ca., qui apparaît déjà sur le plan Ferraris (1770), à la limite de Morlanwelz et de Bellecourt, et le jardin environnant, plus 3 terrains; Wolf, médecin à Mons, une terre de 95 a. 70 ca.; la Bienfaisance de La Hestre, 76 a. 80 ca.; Jean JH. Rectem, 12 parcelles; surtout Nicolas Warocqué, 17 parcelles.
On pourrait croire de prime abord que Nicolas Warocqué détient la partie achetée par son frère et que la moitié acquise par Deshuytener a été morcelée soit par héritage, soit par vente et achat. Un acte officiel passé devant le notaire Lebrun le 29 août 1803, révèle que Nicolas Warocqué a acheté la part de Deschuytener. N'en concluez pas que c'est la moitié de Isidore qui a été dispersée à la suite de la faillite retentissante de ce dernier. Le problème paraît assez complexe, car il semble que des parcelles acquises par Nicolas appartiennent à Rectem en 1835-1840. Par ailleurs Deshuytener n'a-t-il pas aussi vendu ou cédé une partie de ses biens à Daminet, son gendre ?
Que sont devenues les parcelles de Isidore Warocqué ?
Pour répondre à ces questions, il faudrait reprendre patiemment chaque lot et suivre les mutations dans les archives des notaires ou dans celles de l'enregistrement. Un essai tenté dans ce sens montre la difficulté de l'entreprise. De toute façon, quelles archives notariales, outre celles de Lebrun, faut-il dépouiller ?
Sur le plan Popp (1870), on constate :
Que le baron Daminet, d'Henghien, gendre de Deschuytener, a acquis les terrains de Madame Lemaire, et la parcelle cadastrée n° 215 de la Société des Charbonnages de Mariemont, probablement pour compenser l'établissement d'une houillère sur un de ses terrains.
Que Larimant et Antoine de Morlanwelz, ont acquis le terrain de la Bienfaisance de La Hestre; ils l'ont loti et y ont construit six maisons dont 3 déjà en 1838.
Que la propriété Wolf, cadastrée 221, est passée à J-B Triffet, charbonnier de Chapelle-lez-Herlaimont, qui y a fait construire 2 maisons (aujourd'hui : le chant des oiseaux)
Que les propriétés de Nicolas Warocqué sont devenues celles de Abel Warocqué.
Que la Société des Charbonnages de Mariemont a acquis les biens de Rectem et, sur une partie des ruines de l'abbaye, a fait construire ou aménager 31 maisons ouvrières.
Qu'une partie des parcelles et le vieux moulin à eau ont été absorbés lors de la construction du chemin de fer de l'Olive à Bascoup vers 1848.
Actuellement, l'État pour 50%, la province pour 40%, la commune pour 10% possèdent les biens des Warocqué par achat à la famille Guinotte, héritière du dernier Warocqué, Raoul. Les propriétés Charbonnages de Mariemont sont passées à la société Charbonnage du centre à Ressaix qui vend parfois à des particuliers. Ce sont des particuliers aussi qui détiennent aujourd'hui les terrains et maisons qui appartenaient jadis à Larimont et Antoine, et à Triffet; ils y ont d'ailleurs construit divers bâtiments.
A différentes dates, les Français vendirent aussi les autres propriétés de l'Olive :
A Morlanwelz.
4 ha. achetés par Paulée, négociant, rue Boudereau, à Paris ;
15 ha. en 9 parcelles, achetés par D. Gantois, marchand à Mons.
1 ha. acheté par Wolf, de Mons
5 ha. en 2 parcelles, achetés par CH. Ghillenghien, de Mons
3 ha. en 3 parcelles, achetés par le même
A Hyon et Guesmes.
5 ha en 9 parcelles, achetés par Pierre JH. Dutrieu, de Mons, et G. Algrain, de Guesmes, chacun pour moitié.
A Bellecourt.
20 ha. en 3 parcelles, achetés par M. Susane, de Paris
22 ha. en divers lots, achetés par Paulée, de Paris
47 ha. en 7 parcelles, achetés par Paulée, de Paris
5 ha. achetés par Lieppin. ex-religieux, et Martin, ex-religieuse, tous 2 de Mons
10 ha. achetés par Sartou et Bastien, ex-capucin, de Tournai
8 ha. achetés par Dumarets, de Mons
4 ha. achetés par Ardache P.,fils, notaire à Frameries.
A La Hestre et Haine-Saint-Pierre
32 ha. acquis par Paulée, de Paris
3 ha. acquis par le même
1ha acquis par CH. Deghilage, de Mons
A Estinnes
4 ha. en 8 parcelles, adjugés à Louis Abrassart, de Mons
A Carnières
3 ha. en 8 parcelles, non adjugés
A Gouy, Piéton et Chapelle
2 ha. en 2 parcelles, adjugés à P. Lecomte, de Mons
A Arquennes
7 ha. en 2 parcelles, à Lieppin et Liessies, ex-religieux, de Mons
A Mons
Une maison sise 17, rue des Passages, à Sartou et Bastien, de Tournai
A Ressaix, Epinois et Péronnes
8 ha. en 17 parcelles, à Leclercq et Delacroix, son épouse, de Binche.
A Courcelles
17 ha. en 3 parcelles, à J. Preux, de Gosselies
A Heppignies
48 ha en 51 parcelles, à J-m-s Desandrouin, de Paris
L'abbaye de l'Olive détenait donc près de 300 ha. de terres dispersées un peu partout. C'était le cas de toutes les abbayes qui, depuis leur création, avaient acquis de plus en plus de biens surtout par donations diverses. Mais à côté de Lobbes, d'Aulne et de Bonne-Espérance, l'Olive ne figurait que modestement.
En 1896, R. Warocqué fit entreprendre par Ed. Peny des fouilles qui mirent à jour d'importantes substructures, des colonnes de l'église, des pierres tombales, etc... Certaines d'entre elles se trouvent aujourd'hui au musée lapidaire de Mariemont. Warocqué souhaita un moment aménager et sauver ces précieux souvenirs. Il les fit protéger par une toiture en bois et couvrir de dalles en verres les caveaux découverts dans l'ancienne église. Mais ce fut insuffisant. Aujourd'hui, rien ne permet d'identifier l'emplacement de l'abbaye. Seuls les initiés peuvent vous dire qu'en fouillant dans les jardins situés entre la cité et l'ancien chemin de fer de l'Olive, on trouverait d'importants vestiges. Mais recevrait-on l'autorisation ? Et où trouver les crédits nécessaires ?
http://www.morlanwelz.be/histoire/VandenEynde/vente_abbaye_olive.htm (20051203)

19880217: 183 en 186
202303102311: 123 zet de uitdrijving op 13 december 1796